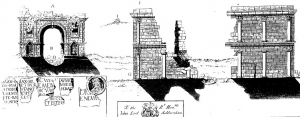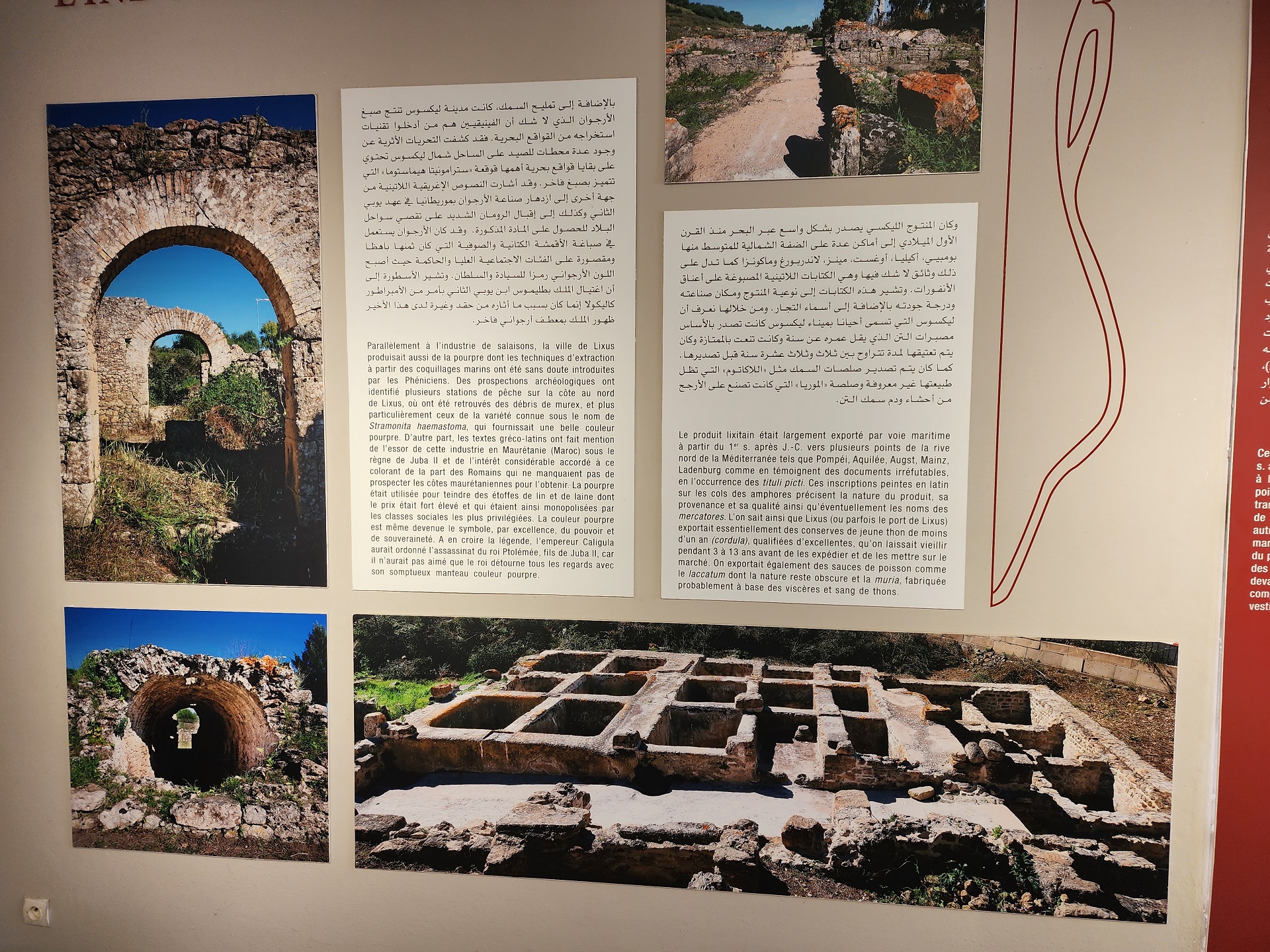Lixus

Webmaster
Djemila dans son paysage
La ville est placée au carrefour de la route est-ouest reliant l’ancienne capitale numide Cirta/Constantine à la colonie nervienne de Sitifis/Sétif, et de l’axe nord-sud reliant Igilgili/Jijel à Lambaesis/Lambèse (Gascou, 1972). Le site est installé sur un plateau rocheux d’une trentaine d’hectares facilement défendable, long de 400 m environ et culminant à une altitude moyenne de 850 m, cerné par deux torrents de montagne profondément encaissés, à savoir à l’est l’oued Bettane et l’oued Guergour à l’ouest. Le choix d’implantation du site a été conditionné par la présence d’importantes réserves d’eau et l’abondance de sources intarissables, mais aussi par un arrière-pays favorable à l’agriculture. L’agglomération primitive a pu être délimitée sur la partie nord de l’éperon, enfermée dans un rempart dont le tracé, relativement bien connu et restauré à une époque tardive, ce rempart dessine un plan triangulaire irrégulier. Partiellement conservé sur parfois 2 à 3 m d’élévation, il est constitué d’un blocage de caillasse et moellons pris entre deux parements en grand appareil et gros moellons pour une épaisseur globale de 2,50 m (Allais, 1971). L’urbanisme intérieur est constitué d’un alignement de rues selon une orientation générale nord-ouest/sud-est avec le grand cardo à l’ouest qui travers tout l’éperon et au bord duquel sont installés depuis le milieu du IIe siècle le forum ainsi que la basilique et le marché des Cosinii (Février, 1996a). Dès le milieu du IIe siècle, en parallèle avec la poursuite de l’aménagement du noyau primitif, la ville s’étend en dehors des remparts, dans la partie méridionale du plateau avec la construction d’un théâtre de 3000 places, des Thermes du Sud édifiées sous le règne de Commode, ou encore de la partie la plus ancienne de la « Maison de Bacchus » (Golvin, 2020). D’autres travaux sont réalisés à la période sévérienne (193-235), comme l’aménagement de la grande place dite forum des Sévères. L’essentiel des constructions de Cuicul a pu être assurément daté grâce aux nombreux témoignages épigraphiques découverts lors des fouilles, même s’il existe deux hiatus chronologiques, du fait de l’absence de dédicaces, entre l’époque des Sévères et 281 d’une part, entre 295 et la seconde moitié du IVe siècle d’autre part (Février, 1996a). Les IVe et Ve siècles sont capitaux dans le paysage urbain de Cuicul puisqu’ils représentent l’état le plus récent du site, comprenant l’édification de l’important ensemble monumental du groupe épiscopal, de nombreux bâtiments publics et de grandes maisons richement décorées de mosaïques (Blanchard-Lemée, 1975, 1998). Concernant l’approvisionnement en eau, bien que Cuicul fût dotée de quelques puits, l’alimentation principale était générée en continue par un aqueduc qui captait l’eau des sources au sud de la ville, puis se divisait en plusieurs branches souterraines afin d’alimenter les différents quartiers et de grandes citernes, ces dernières collectant également les eaux de pluies employées notamment dans les thermes de Cuicul. Plusieurs fontaines installées en divers points de la cité assuraient la distribution (Allais, 1933). La documentation archéologique concernant Cuicul/Djemila est considérable, mais paradoxalement difficilement exploitable. Paul-Albert Février, qui a activement contribué à la connaissance scientifique du site à partir des années 1960, regrette l’imprécision des plans anciens des divers monuments ainsi que la faiblesse des descriptions au moment de la découverte et avant restauration (Février, 1996a). En effet, les rapports d’Albert Ballu contiennent nombre de descriptions confuses, de plans inexacts ou sommaires qui rendent difficile la compréhension a posteriori des découvertes, mais demeurent des sources irremplaçables (Blanchard-Lemée, 1975). En effet, Malgré le nombre important d’interventions archéologiques tout au long du XXe siècle, nous n’avons aujourd’hui que trop peu de données géologiques, géomorphologiques, et surtout stratigraphiques en dehors des sondages de la « Maison de l’Âne » (Blanchard-Lemée, 1975).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Djemila dans l’histoire
Le site de Cuicul/Djemila a suscité tout au long du XXe siècle un débat au sujet de la fondation de la colonie romaine. Sur la foi des découvertes épigraphiques, les spécialistes attribuent sa fondation soit aux vétérans de Nerva, soit à Trajan. René Cagnat, partisan de la première hypothèse, argumente en faveur d’une fondation simultanée avec la proche Sitifis, quant à elle d’origine nervienne assurée, afin de faciliter les liaisons entre la Numidie et la Maurétanie. De son côté, l’épigraphiste Jacques Gascou considère que les arguments avancés par Cagnat demeurent trop fragiles. Gascou estime notamment que le règne de Nerva a été beaucoup trop court (16 mois) pour s’être activement employé en Afrique, au contraire de son fils Trajan (Gascou, 1972). Néanmoins, même si la question de l’attribution de la fondation de Cuicul n’est pas totalement tranchée, son origine peut quand même être arrêtée entre la fin du Ier siècle et le début du IIe siècle de notre ère, la première mention de Cuicul en tant que colonie étant attestée explicitement au milieu du IIe siècle par Ptolémée (Février 1996b, Dupuis, 2006). L’archéologie n’a pas encore démontré l’existence d’une occupation antérieure à la création de la colonie, même si le nom de Cuicul pourrait être l’évocation d’un toponyme berbère. Seuls des sondages archéologiques localisés à partir de l’arrêt des fouilles anciennes et sous les bâtiments antiques pourraient permettre de déceler les traces d’une occupation antérieure. Cuicul apparait dans son histoire comme une petite agglomération provinciale considérablement romanisée, habitée par une population élitaire ou du moins relativement aisée comme en témoigne la monumentalité des bâtiments publics et des habitats. Un tremblement de terre, survenue en Méditerranée le 21 juillet 365, aurait causé plusieurs incendies et la destruction de plusieurs édifices de la ville, dont le Temple de Frugifer, qui ne fut pas reconstruit mais remplacé par une basilique. Les habitants auraient alors réemployé les matériaux des ruines récentes dans de nouveaux aménagements (Rebuffat, 1980). Depuis le milieu du IIIe siècle, le christianisme s’implante profondément dans la petite cité de Cuicul avec le culte de martyrs locaux. Cinq évêques de la ville sont plus précisément connus dans les textes : trois pour avoir participé à plusieurs conciles tenus à Carthage (Pudentianus en 256, Elpidophorus en 348 et Cresconius en 411), un sous l’occupation vandale (Victor en 484) et le dernier nommé Crescens, qui a siégé en 553 au concile de Constantine et qui était évêque de l’église de Cuicul durant la domination byzantine. L’archéologie a révélé, au sein du groupe épiscopal situé dans le faubourg sud-est de la ville à 150 m au sud du théâtre, deux basiliques aux sols pavés de mosaïques, un baptistère avec bains, une chapelle ainsi que les résidences du corps religieux (Monceaux 1920, 1922). Les descendants des vétérans ont, semble-t-il, mené à Cuicul une vie paisible et prospère jusqu’à son probable abandon au cours du VIe siècle, quand la cité tomba progressivement dans l’oubli. Une tradition locale attribue à Abou al-Mouhajir Dinar, émir de l’Ifriqiya, la capture de Cuicul durant le dernier quart du VIIe siècle (Kaegi, 2010). Bien que les auteurs et chroniqueurs arabes médiévaux ne fassent aucune mention d’une ville sur l’emplacement de Cuicul, les réserves du musée de Djemila conservent encore de la céramique locale et vernissée ainsi que des lampes, retrouvées en fouilles, semblables à celles découvertes sur le site médiéval de la Kalâa des Beni Hammad (XIe-XIIe s.). Sous réserve d’investigations archéologiques plus approfondies consacrées à ces périodes, ces indices pourraient témoigner d’une possible occupation islamique sur le site (Février 1996a). A l’instar d’autres sites antiques d’Afrique du Nord fouillés entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, les niveaux islamiques ont probablement été en grande partie détruits. Enfin, à l’orée des premières explorations scientifiques, un poste militaire français fut établi en 1838 par un petit bataillon d’infanterie légère qui subit des assauts plusieurs jours durant, utilisant les ruines comme bouclier (Rousset, 1887 ; Ballu, 1921).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Djemila aujourd'hui
Situé une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la wilaya de Sétif, en bordure du Constantinois, le site archéologique de Djemila abrite les vestiges de la ville antique de Cuicul (Cuiculum), fondée pour les vétérans des légions romaines au tournant du IIe siècle de notre ère. Le site des ruines de Djemila est classé au patrimoine national algérien par l’ordonnance 67-281 du 20 décembre 1967, et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 décembre 1982 (numéro d’identification 191). Avec la loi N° 98-04 du 15 juin 1998, la gestion du site est confiée à l'Office de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels (OGEBC). L'OGEBC est chargé, outre les missions de service public, de protection, d'entretien et de valorisation, de mettre en œuvre le plan de protection et de mise en valeur du site (PPMVSA), en coordination avec la Direction de la Culture de la Wilaya de Sétif. Le site est doté depuis 1910 d’un musée accueillant le mobilier issu des fouilles, notamment les prestigieuses mosaïques. Il est installé dans la partie sud de la zone archéologique clôturée (d’une superficie de 30,6 ha), à proximité de laquelle s’est développée la ville moderne. En 2004, le premier Festival de la Chanson Arabe est organisé au cœur de la zone archéologique, sur la place des Sévères, avant d’être délocalisé en 2012 sur un terrain extérieur à cause des dégradations causées sur les vestiges, principalement dans le théâtre antique.
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Bibliographie
AKERRAZ, Aomar, 1985, « Note sur l’enceinte tardive de Volubilis », Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 19, p. 429‑438.
AKERRAZ, Aomar, 1998, « Recherches sur les niveaux islamiques de Volubilis », in P. Cressier et M. García-Arenal, Genèse de la ville Islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental. Madrid, Casa de Velázquez, p. 295‑304.
AKERRAZ, Aomar, BROUQUIER-REDDÉ, Véronique, DEKAYIR, Abdelilah, DESRUELLES, Stéphane, HERMITTE, Daniel, PARISOT, Jean-Claude, ALILOU, M'Hamed, HOUAL, Jean-Baptiste, ROUAI, Mohamed, SIDI CHEIKH, Brahim, et BENYASSINE, El Mehdi, 2018, « Les aqueducs de Volubilis et leurs captages : approches archéologiques, géoarchéologiques et géophysiques », in V. Brouquier-Reddé et F. Hurlet, L'eau dans les villes du Maghreb et leur territoire à l'époque romaine, Bordeaux, Ausonius Editions, p. 397-418.
AKERRAZ, Aomar, et LENOIR, Eliane, 1990, « Volubilis et son territoire au Ier siècle de notre ère », Publications de l’École Française de Rome, 134 (1), p. 213‑229.
http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1990_act_134_1_3875.
AKERRAZ, Aomar et LENOIR, Maurice, 1982, « Les huileries de Volubilis », Bulletin d’Archéologie Marocaine, XIV, p. 69‑134.
AL-BAKRÎ, 1913, Description de l’Afrique septentrionale, trad. De Slane, W. M. G., Alger, Adolphe Jourdan.
https ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k104409x
AUGUSTIN, Ferdinand Freiherrn von, 1838, Erinnerungen aus Marokko, Wien, Schaumburg.
http://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/ssg/content/titleinfo/770225
BERTHIER, Paul, 1938, Essai sur l'histoire du massif de Moulay Idris de la conquête musulmane à l'établissement du Protectorat français, Rabat, Moncho.
BROUQUIER-REDDÉ, Véronique, EL KHAYARI, Abdelaziz, ICHKHAKH, Abdelfattah, 1998, « Le temple B de Volubilis : nouvelles recherches », Antiquités africaines, 34, p. 65-72.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1998_num_34_1_1284
CALLEGARIN, Laurent, 2016, « L’étude des découvertes de monnaies d’époque maurétanienne sur le site de Volubilis et dans ses environs », in M. El Rhaiti et M. Makdoun, Le Patrimoine maure (amazigh) de Volubilis. Acte de colloque, Meknès 24-25 mars 2012, Série Actes de Colloques 45. Université Moulay Ismaîl, Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, p. 201‑230.
CHATELAIN, Louis, 1916, « Les fouilles de Volubilis à l’exposition de Casablanca », Journal des Savants, 14 (1), p. 36-38.
https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1916_num_14_1_4505
CHATELAIN, Louis, 1944, Le Maroc des Romains. Étude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale, Paris, De Boccard.
http://www.tpsalomonreinach.mom.fr/Reinach/MOM_TP_135099/MOM_TP_135099_0001/PDF/MOM_TP_135099_0001.pdf
CUQ, Édouard, 1920, « La cité punique et le municipe de Volubilis », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 64 (4), p. 339-350.
https://www.persee.fr/docAsPDF/crai_0065-0536_1920_num_64_4_74352.pdf
DOMERGUE, Claude, 1963, « L’arc de triomphe de Caracalla à Volubilis », École pratique des Hautes Études, 4e section, Sciences historiques et philologiques, Annuaire 1963-1964, p. 283-293.
https://www.persee.fr/doc/ephe_0000-0001_1963_num_1_1_4776
DRESCH, Jean, 1930, « Le massif de Moulay Idriss (Maroc septentrional) », Annales de Géographie, 39 (221), p. 496-510.
www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1930_num_39_221_10245
EL BOUZIDI, Saïd et OUAHIDI, Ali, 2014, « La frontière méridionale de la Maurétanie Tingitane : contribution à la carte archéologique de la région de Volubilis », Dialogues d’histoire ancienne, 40 (1), p. 97‑108.
http://www.persee.fr/doc/dha_0755-7256_2014_num_40_1_3905.
EL HABASHI, Alaa, MOUJOUD, Tarik et ZIZOUNI, Abdessalam, 2016, « The Conservation and Reconstruction of the Islamic Bath at Volubilis, Morocco ». Journal of Fasti, 11.
http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-con-2016-4.pdf
EL KHAYARI, Abdelaziz, 1994, « Les thermes extra-muros à Volubilis », L’Africa Romana. Actes du Xe colloque d’études, Oristano, 11613 décembre 1992, p. 301-312.
EN-NAÇIRI ES-SLAOUI, Ahmed ben Khaled, 1925, « Kitab el-Istiqça li akhbar Doual el-Maghrib el-Aqça, (histoire du Maroc), Tome II : Les Idrissides, Traduit par A. Graulle », Archives marocaines, XXXI , p. 1-110.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106589j
ÉTIENNE, Robert, 1960, Le quartier nord-est de Volubilis, Paris, De Boccard.
EUZENNAT, Maurice, 1956, « Deux voyageurs anglais à Volubilis (1721) », Hespéris, 43, p. 325-334.
http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1959-1950/131-hesperis-tamuda-1956
EUZENNAT, Maurice, 1974, « Les édifices du culte chrétiens en Maurétanie tingitane », Antiquités Africaines, 8, p. 175-190.
https://www.persee.fr/docAsPDF/antaf_0066-4871_1974_num_8_1_952.pdf
FAGNAN, Edmond, 1900, L’Afrique septentrionale au XIIe siècle de notre ère. Description extraite du Kitab el-Istibçar, Constantine, Adolphe Braham.
FAGNAN, Edmond, 1924, Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger, Jules Carbonel.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5806909m
FENTRESS, Elizabeth, LIMANE, Hassan, (eds), (2018), Volubilis après Rome. Les fouilles UCL/INSAP, 2000-2005, Boston, Brill.
GOLVIN, Jean-Claude, 2020, L’Antiquité retrouvée, Arles, Éditions Errance, p.146.
HOOKER, Joseph Dalton, 1878, Journal of a tour in Marocco and the Great Atlas, London, Macmillan and Co.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98288j
IBN KHURDÂDHBAH, 1865, « Le Livre des Routes et des Provinces, trad. C. Barbier de Meynard », Journal Asiatique, sixième série, tome V, p. 446-532.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k931851
LA MARTINIÈRE, Henri Poisson de, 1912, « Volubilis », Journal des Savants, 10-1, p. 34-41.
https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1912_num_10_1_3836
LEARED, Arthur, 1878, « The site of the roman city of Volubilis », The Academy, vol.13, Jan-Jun 1878, p. 580-581.
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015035575201&view=1up&seq=646&q1=volubilis
LENZ, Oskar, trad. de Lehautcourt, P., 1886, Timbouctou. Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, tome 1, Paris, Hachette.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1048451
LÉON L’AFRICAIN, trad. d’Épaulard, A., 1981, Description de l’Afrique, tome 2, Paris, Maisonneuve et Larose.
LIMANE, Hassan, REBUFFAT, René, DROCOURT, Daniel, 1998, Volubilis. De mosaïque en mosaïque, Casablanca, Edisud Eddif.
MAKDOUN, Mohammed et ICHKHAKH, Fattah (ed.), 2019, Recherches archéologiques sur la partie Nord-Est et Est du Quartier monumental du site de Volubilis, Meknès, CNRST.
MORESTIN, Henri, 1980, Le temple B de Volubilis, Paris, Editions du CNRS.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33336768
PANCANI, G., GALASSI, S., ROVERO, L., DIPASQUALE, L., FAZZI, E., TEMPESTA, G., 2020, « Seismic vulnerability assessment of the triumphal arch of Caracalla in Volubilis (Morocco): past events and provisions for the future », International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIV-M-1-2020, p. 435-442.
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLIV-M-1-2020/435/2020/
PANETIER, Jean-Luc et LIMANE, Hassan, 2002, Volubilis. Une cité du Maroc antique, Paris, Maisonneuve et Larose.
PONSICH, Michel, 1976, « Le temple dit de Saturne à Volubilis », Bulletin d’Archéologie Marocaine, X, p. 131-144.
SIRAJ, Ahmed, 1995, L'image de la Tingitane. L'historiographie arabe médiévale et l’Antiquité nord-africaine, Rome, Publications de l'École française de Rome, 209.
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1995_ths_209_1
SOUVILLE, Georges, 1956, « La Préhistoire au Musée de Volubilis », Hespéris, XLIII, p. 457-461.
http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1959-1950/131-hesperis-tamuda-1956
TISSOT, Charles-Joseph, 1877, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, Paris, Imprimerie Nationale.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105862v.image
WINDUS, John, 1725, A journey to Mequinez, the residence of the present emperor of Fez and Morocco, on the occasion of Commodore Stewart's embassy thither from the redemption of the British captives in the year 1721, London, Jacob Tonson.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041166.image
Les recherches les plus récentes ou en cours à Volubilis
Les opérations archéologiques se sont multipliées sur le site de Volubilis tout au long du XXe siècle avec le passage de grands spécialistes des sciences de l’Antiquité. Les trente dernières années ont indubitablement apporté un renouveau de l’archéologie grâce à l’application de nouvelles méthodes sur le terrain, l’émergence de nouvelles problématiques de recherche portées par des programmes pluridisciplinaires et le souci de la formation et la transmission des savoirs. C’est sur cette base que s’est constitué, à la fin des années 1980, un nouveau programme de fouille à Volubilis sous forme de stages au bénéfice des étudiants de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP). Les quatre campagnes de terrain d’un mois, qui ont eu lieu entre 1988 et 1993, ont dégagé, sur une zone d’environ 3 000 m2 au nord de la Maison au Compas, une occupation domestique de la deuxième moitié du VIIIe et du début du IXe siècle (Akerraz, 1998). C’est dans ce même secteur, situé de la Maison au Compas à la Maison à la Citerne et fouillé par plusieurs équipes d’archéologues dans la deuxième moitié du XXe siècle, qu’avait été localisée l’une des nécropoles d’époque musulmane (Euzennat, 1974). Toujours dans les années 1990, l’étude architecturale approfondie corrélée à des sondages archéologiques des thermes extra-muros fouillées en 1964 par Bernard Rosenberger dans la partie sud-ouest du site, a permis de dater également cet édifice de l’époque idrisside (El Khayari, 1994 ; El Habashi et al., 2016 ; Fentress et Limane, 2018). De 2000 à 2004, une équipe pluridisciplinaire maroco-anglaise, co-dirigée par Elizabeth Fentress (University College of London) et Hassan Limane (INSAP), a réalisé une importante série de travaux visant à étudier les occupations post-romaine, pré-islamique et islamique, à travers à la fois un réexamen de certains monuments et l’ouverture de nouvelles aires de fouilles. Ces nouvelles recherches ont montré comment des habitats élitaires ont perduré jusqu’à un séisme brutal intervenu dans la première moitié du Ve siècle. Le secteur à proximité des thermes extra-muros aurait constitué un quartier nouveau construit à la fin du VIIIe siècle concomitant à l’arrivée d’Idris Ier, tandis que celui près de la muraille tardive a été occupé entre le VIIe et le IXe siècle (Fentress et Limane, 2018). Depuis 2018, un nouveau programme pluridisciplinaire maroco-anglais INSAP/UCL poursuit les investigations archéologiques au cœur de l’implantation islamique du site. Ces travaux récents détonnent par rapport aux recherches du siècle dernier focalisées sur la Volubilis antique. Pour autant, ces périodes anciennes ont continué de susciter l’intérêt des chercheurs. Dans le cadre d’un programme de recherche maroco-français sur les monuments religieux du Maroc antique, des fouilles ponctuelles ont été menées en 1996 sur le temple B, partiellement dégagé par Chatelain en 1919, puis fouillé en 1954 par Michel Ponsich et de 1955 à 1961 par Henri Morestin, qui y découvrit l’une des plus importantes séries de stèles d’Afrique du Nord (Ponsich, 1976 ; Morestin, 1980 ; Brouquier-Reddé et al., 1998). Ces travaux des années 1990 ont décelé quatre états successifs s’étalant entre le tournant de l’ère et le milieu du IIe siècle, dont le plus ancien était une aire sacrée accueillant des urnes cinéraires. Enfin, l’équipe pluridisciplinaire marocaine du projet Protars P3T2/06 a conduit entre 2002 et 2008 des fouilles dans le secteur Est et Nord-Est de la basilique afin d’affiner la chronologie de ce secteur en exhumant les occupations primitives d’époque maurétanienne (Makdoun et Ichkhakh, 2019).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Histoire de la recherche à Volubilis
La plus ancienne description des ruines de Volubilis est attribuée à l’ambassadeur britannique John Windus qui a parcouru le site de « Cassar Pharaon » le 1er juillet 1721. Il a fourni à cette occasion un premier relevé des monuments en élévation, enclos par un mur, dont l’emblématique arc de triomphe érigé entre 216 et 217 de notre ère en l’honneur de Caracalla et de sa mère Julia Domna (Windus, 1725 ; Domergue, 1963). Un autre croquis de ce monument a été réalisé en 1830 par l’autrichien Ferdinand von Augustin lors de sa visite du site. Bien que plus romantique que le précédent, ce document précieux illustre cependant les dégâts (effondrement de la voûte) causés par le puissant tremblement de terre de 1755, qui ravagea par ailleurs la ville de Lisbonne au Portugal. L’état actuel du monument résulte d’une restauration des années 1930 quelque peu décriée (Augustin, 1828 ; Euzennat, 1956 ; Pancani et al., 2020). Plusieurs voyageurs européens ont par la suite fréquenté le site de Volubilis à partir des années 1870. En 1874, au retour d’une mission topographique à Meknès, le spécialiste des voies romaines de la Maurétanie tingitane Charles-Joseph Tissot, alors ministre plénipotentiaire de France au Maroc, a décrit brièvement quelques vestiges dont ceux de l’enceinte, de l’arc de triomphe et de ce qu’il identifia comme la basilique (Tissot, 1877). Trois ans plus tard, ce fut au tour du physicien irlandais Arthur Leared, accompagnant une ambassade portugaise, de proposer ses observations, relayé l’année suivante par les anglais W. H. Richardson et H. B. Brady, membres de la prestigieuse Royal Society, puis en 1880 par l’explorateur allemand Oskar Lenz qui lança un appel aux archéologues pour approfondir les connaissances du lieu (Hooker, 1878 ; Leared, 1878 ; Lenz, 1886). Les premières interventions archéologiques à Volubilis ont été conduites de 1888 à 1890, avec l’autorisation du sultan Moulay Hassan, par Henri Poisson de La Martinière alors chargé d’une mission scientifique au Maroc. Il dressa un premier plan de répartition des vestiges et entreprit des travaux de dégagements, notamment aux abords de l’arc de triomphe et du forum ainsi que sur une nécropole, où il constata des traces antérieures de pillage (La Martinière, 1912). Sous l’impulsion du résident général Lyautey, la reprise des fouilles à Volubilis fut confiée à Louis Chatelain, lieutenant au 4e régiment de tirailleurs indigènes, qui dégagea, dès 1915, toujours dans la zone comprise entre l’arc de triomphe et le forum, des constructions inédites permettant de mieux appréhender l’urbanisme antique, ainsi que des mosaïques et de nombreuses inscriptions latines, des découvertes qui furent mises à l’honneur quelques mois plus tard dans une salle dédiée à l’occasion de l’Exposition de Casablanca (Chatelain, 1916). Louis Chatelain œuvra activement sur le site jusqu’en 1941 et participa, entre autres, à la découverte du mobilier exceptionnel qui fait aujourd’hui la richesse de ce site, dont les mosaïques et les statuettes en bronze (Chatelain, 1944 ; Limane et al., 1998). Un grand nombre d’archéologues a par la suite pérennisé l’exploration scientifique de Volubilis et de ses origines dans la seconde moitié du XXe siècle (Panetier et Limane, 2002). Nous pouvons citer, à titre d’exemple, les fouilles de Robert Étienne dès 1941 qui ont contribué à documenter l’urbanisme complet (habitat, hydraulique, voirie …) d’un quartier résidentiel dans la partie nord-est du site (Étienne, 1960). Diverses opérations de restauration ont été accomplies dans les années 1960 sur le Capitole, la basilique et la Porte de Tanger.
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Volubilis dans son paysage
Le site de Volubilis occupe un plateau triangulaire naturellement protégé d’environ 900 mètres de long sur 300 mètres de large, culminant à une altitude moyenne de 400 m et relié en pente douce au massif du Zerhoun au sud. Les vestiges archéologiques sont principalement disséminés au sein d’une zone traversée à l’est par l’oued Fertassa, et contournée au sud et au sud-ouest par l’oued Khoumane. L’occupation maurétanienne, qui disposait d’un urbanisme plutôt régulier enfermé dans une enceinte, était essentiellement concentrée autour du centre monumental qui accueillit plus tard le Capitole et le forum. L’agglomération romaine s’étendait sur l’ensemble de la zone archéologique, avec toutefois une aggradation des infrastructures publiques et de l’habitat dans la partie centrale du site puis, dès la fin du Ier siècle de notre ère, une extension vers le quartier nord-est de part et d’autre du decumanus maximus, ce dernier aboutissant à la Porte de Tanger qui flanquait la grande enceinte de la deuxième moitié du IIe siècle. Seul le temple B apparait isolé sur un mamelon à l’écart de la ville. Les occupations post-romaine et islamique étaient, dans l’état actuel de nos connaissances, restreintes à la partie occidentale du site sur la rive droite de l’oued Khoumane et à l’intérieur de la grande enceinte, à l’exception du hammam et d’un faubourg à l’extérieur de la Porte à Deux Baies. Des nécropoles tardives étaient installées au-delà de l’enceinte tardive à l’est au cœur des anciens quartiers d’habitation, tandis que des traces de nécropoles romaines ont été repérées au nord de la grande enceinte. Pour assurer la vie quotidienne de sa population, la ville de Volubilis bénéficiait d’importantes ressources hydriques, tant de surface (du fait de la proximité des deux oueds) que souterraines (du fait des nombreuses sources s’alignant sur les pentes du Zerhoun). La source de Fertassa, en particulier, a alimenté la majorité des édifices de Volubilis par le moyen d’un aqueduc souterrain, édifié à la fin du Ier siècle de notre ère et divisé en plusieurs branches desservant les différents quartiers de la cité romaine (Akerraz et al., 2018). Même si la recherche archéologique a révélé un grand nombre de vestiges de stockage et de distribution de l’eau propre ainsi que de systèmes d’évacuation des eaux usées, les témoignages de structures de puisage sont beaucoup plus rares. Au-delà de la ville, Volubilis jouissait d’un environnement immédiat riche en ressources variées, dont l’exploitation participait de sa prospérité économique. Le massif du Zerhoun offrait les ressources minérales et végétales indispensables à la construction et à l’embellissement de la ville, ainsi que des terrains de parcours pour les troupeaux. Sur le piémont, on cultivait les céréales, les légumes, la vigne, et surtout l’olivier dont la transformation du fruit est bien attestée dans les fouilles anciennes comme en témoigne la cinquantaine d’huileries découvertes sur le site de Volubilis (Dresch, 1930 ; Akerraz et Lenoir, 1982). Des prospections systématiques ont montré que l’arrière-pays de Volubilis était densément occupé dès l’époque préromaine par toute une série d’établissements ruraux, avec cependant une intensification des constructions à partir du Ier siècle de notre ère et une surveillance militaire de la région marquée par l’édification de tours de guet et de camps dont Aïn Schkour et Tocolosida (Akerraz et Lenoir, 1990 ; El Bouzidi et Ouahidi, 2014).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Volubilis dans l'histoire
La plupart des rares références datant du Ier siècle de notre ère se contentent de mentionner le nom de la ville sous différents vocables. C’est finalement Volubilis, que l’on retrouve chez Pomponius Mela, ou le Volubile oppidum de Pline l’Ancien, qui s’est imposé dans l’usage, bien qu’une racine berbère oualili (le « laurier-rose ») soit sans doute à l’origine du nom latinisé (Chatelain, 1944). Le site de Volubilis a été fréquenté dès la Préhistoire, comme le suggèrent un certain nombre d’objets (haches polies, racloirs en silex …) provenant des déblais de fouilles (Souville, 1956 ; Panetier et Limane, 2002). L’archéologie a démontré que l’emplacement de Volubilis abritait un centre urbain actif à l’époque maurétanienne, mettant en évidence pour ces périodes anciennes des vestiges d’édifices religieux et funéraires, des céramiques importées ainsi que des inscriptions en punique et néopunique tant sur des monnaies que sur d’autres supports. L’une de ces inscriptions laisse supposer l’instauration d’une institution carthaginoise, le suffétat, au moins au IIIe siècle avant notre ère (Cuq, 1920 ; Akerraz et Lenoir, 1990 ; Callegarin, 2016). En 44 de notre ère, faisant suite à l’annexion du royaume de Maurétanie par Rome, l’empereur Claude attribua à la cité pérégrine, pour récompenser le soutien de sa population lors des révoltes survenues en 40 après l’assassinat du roi maurétanien Ptolémée, le statut de municipium. Dès lors, la ville continue à croître en adoptant progressivement le mode de vie romain et toutes les infrastructures administratives, politiques, religieuses et sociales qu’il incluait (basilique, forum, Capitole, temples, thermes, riches demeures …), ainsi qu’une grande enceinte de 2,35 km de long érigée en 168-169, flanquée de huit portes et d’une quarantaine de tours semi-circulaires tous les 60 mètres (Golvin, 2020). A son apogée au début du IIIe siècle, sa population cosmopolite, perceptible à travers les nombreux témoignages épigraphiques découverts sur le site, est estimée entre 10 000 et 20 000 habitants (Etienne, 1960 ; Akerraz et Lenoir, 1990). A la fin du IIIe siècle, l’administration romaine ordonna l’évacuation de la ville, de même que Banasa ou Thamusida dans la plaine du Gharb. Ce retrait s’accompagna d’un profond bouleversement social pour les habitants qui décidèrent de rester et du déplacement progressif de l’occupation principale dans la partie occidentale de la ville à proximité de la rivière. Vers la fin du VIe siècle, les nouveaux noyaux d’habitat sont enfermés à l’intérieur d’une enceinte construite avec des blocs prélevés sur les édifices des quartiers abandonnés (Akerraz, 1985). Les nouveaux occupants, membres de la tribu berbère des Awraba, accueillirent en 788 celui qui deviendra quelques temps après le fondateur de la dynastie idrisside, Idris Ier, qui y vécut et y mourut quelques années plus tard (Al-Bakrî, 1913 ; En-Naçiri es-Slaoui, 1925). Les sources arabes médiévales apportent peu d’informations sur le site, qui porte désormais le nom de Walîlâ, et parlent d’une ville de moyenne importance (quand elle est mentionnée dans les textes) par rapport à Fès, la capitale du royaume idrisside fondée par Idris II, successeur et fils d’Idris Ier (Ibn Khurdâdhbah, 1865). L’antiquité de la ville reste, par ailleurs, attestée par certains auteurs des XIIe et XIIIe siècle, qui mentionnent également le toponyme Taysira (les « pierres » en berbère), comme une ancienne capitale du Maghreb dans la période antéislamique (Fagnan, 1900, 1924). Au XVIe siècle, Hasan al-Wazzân (Jean-Léon l’Africain) désigne du nom de Gualili la ville actuelle de Moulay Driss Zerhoun, tandis que l’emplacement de Volubilis est appelé Palais du Pharaon, un vocable parfois donné aujourd’hui encore par les populations locales (Berthier, 1938 ; Léon l’Africain, 1981 ; Siraj, 1995 ; Fentress et Limane, 2018).
(Thomas Soubira, février 2021)
Volubilis aujourd’hui
Le site de Volubilis est situé à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Meknès et à quatre kilomètres au nord-ouest de la petite ville de Moulay Idriss Zerhoun, qui abrite le mausolée et la zaouïa d’Idrîs Ier. Les vestiges de l’ancienne cité antique, berbère puis romanisée, partiellement occupée à l’époque islamique (Walîla), sont concentrés sur une quarantaine d’hectares au sommet d’une colline et sur ses flancs, au bord de l’oued Khoumane. Le site des ruines de Volubilis, ancienne capitale du royaume de Maurétanie, est classé au patrimoine national marocain par le Dahir du 14 novembre 1921 (14 rebia I 1340). Du fait de son caractère exceptionnel pour l’histoire et l’archéologie des provinces romaines d’Afrique du Nord, ainsi que pour sa remarquable conservation, il a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. Même si une partie importante du mobilier découvert lors des fouilles de la première moitié du XXe siècle est conservée et exposée au Musée de l’histoire et des civilisations de Rabat, le site est équipé depuis 2013 d’un centre d’interprétation voué à l’accueil des scientifiques et à la valorisation des collections, ainsi qu’un parcours de visite ponctué de panneaux explicatifs et de restitutions de structures telles qu’une huilerie. Malgré sa protection, le site a subi plusieurs tentatives de pillage. Le vol au début des années 1980 d’une statue en marbre du dieu Bacchus a provoqué une onde de choc dans l’opinion, faisant même intervenir publiquement le roi Hassan II. De 2000 à 2011, le site a accueilli le Festival international de Volubilis, « carrefour de dialogue interculturel et de brassage des arts », délocalisé à présent à Meknès pour éviter la dégradation des vestiges.
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Bibliographie
AMMAR, Hakim, 2007, Les monuments des eaux à Sala dans l’Antiquité, thèse de doctorat en archéologie, Université Paris I.
BADIA Y LEBLICH, Domingo, 1814, Voyages d'Ali-Bey el Abbassi (Domingo Badia y Leyblich) en Afrique et en Asie : pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807, vol. 1, Paris, Imprimerie P. Didot l’Ainé.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1035856
BASSET, Henri, 1919, « La nécropole romaine de Chella », France-Maroc, III (5), p.131-134.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6120145x
BASSET, Henri et LÉVI-PROVENÇAL, Évariste, 1922, « Chella. Une nécropole mérinide », Hespéris, 2, p.1-92, 255-316, 385-425.
http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1929-1921/156-hesperis-tamuda-1922
BERARD, Victor, 1902, Les Phéniciens et l’Odyssée, Paris, Librairie Armand Colin, p. 172.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5724558d.texteImage#
BEN AMARA, Ayed, SCHVOERER, Max, HADDAD, Mustapha, AKERRAZ, Aomar, « Recherche d'indices sur les techniques de fabrication de zelliges du XIVe siècle (Chellah, Maroc) », Revue d'Archéométrie, 27, p.103-113.
https://www.persee.fr/doc/arsci_0399-1237_2003_num_27_1_1046
BOUBE, Jean, 1966, « Fouilles archéologiques à Sala », Hespéris-Tamuda, VII, p.23-32.
http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1969-1960/118-hesperis-tamuda-1966
BOUBE, Jean, 1972, « Les fouilles de la nécropole de Sala et la chronologie de la terra sigillata hispanique », Bulletin d’Archéologie Marocaine, VIII, p.109-126.
BOUBE, Jean, 1984, « Les origines phéniciennes de Sala de Maurétanie », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, 17B, p.155-170.
BOUBE, Jean, 1999, Les nécropoles de Sala, Paris, Editions Recherche sur les Civilisations.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33281406
BRIDOUX, Virginie, 2008, « Les établissements de Maurétanie et de Numidie entre 201 et 33 av. J.-C. Synthèse des connaissances », Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 120 (2), p.369-426.
www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2008_num_120_2_10477
BUSNOT, Dominique, 1724, Relation de ce qui s'est passé dans les trois voyages que les religieux de l'ordre de Nostre-Dame de la Mercy ont faits dans les estats du Roy de Maroc, pour la rédemption des captifs en 1704, 1708 et 1712, Paris, Antoine-Urbain Coustelier.
CHATELAIN, Louis, 1944, Le Maroc des Romains. Étude sur les centres antiques de la Maurétanie occidentale, Paris, De Boccard.
http://www.tpsalomonreinach.mom.fr/Reinach/MOM_TP_135099/MOM_TP_135099_0001/PDF/MOM_TP_135099_0001.pdf
CHÉNIER, Louis de., 1787, Recherches historiques sur les Maures et histoire de l'Empire de Maroc, 3 vol., Paris.
DOUTTÉ, Edmond, 1914, En tribu : missions au Maroc, Paris, Paul Geuthner.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541158c
GASCOU, Jacques, 1991, « Hypothèse sur la création du municipe de Sala », Antiquités Africaines, 27, p.151-156.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1991_num_27_1_1196
HANSALI, Meriem, 2012, Le quartier à vocation artisanale et commerciale de Sala dans l'Antiquité, thèse de doctorat en archéologie, Université Paris I.
JACKSON, James Grey, 1809, An Account of Morocco and the District of Suse, London, Nicol & Son.
LÉON L’AFRICAIN, trad. d’Épaulard, A., 1981, Description de l’Afrique, tome 1, Paris, Maisonneuve et Larose.
PAUTY, Edmond, 1944, Le site de Chella à travers les âges, Rabat, École du Livre.
PIETROBELLI, Antoine, 2001, « Chella mystérieux ou l'archéologie d'un paysage », Horizons Maghrébins, 45, p.116-129.
https://www.persee.fr/doc/horma_0984-2616_2001_num_45_1_1992
SEDRA, Moulay Driss, 1998, La Nécropole de Chella. Etude historique et archéologique de deux monuments : la mosquée et la madrasa, mémoire de IIe cycle, INSAP, Rabat.
SIRAJ, Ahmed, 1995, L'image de la Tingitane. L'historiographie arabe médiévale et l’Antiquité nord-africaine, Rome, Publications de l'École française de Rome, 209.
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1995_ths_209_1
SOUVILLE, Georges, 1961, « La Préhistoire au Musée Louis Chatelain à Rabat (Maroc) », Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 58, n°5-6, p. 309-313.
https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1961_num_58_5_3752
TAMÁS NAGY, Péter, 2014, « Sultans’ paradise: The royal necropolis of Shāla, Rabat », al-Masāq: Journal of the Medieval Mediterranean, 26 (2), p.132-146.
https://doi.org/10.1080/09503110.2014.915103
TERRASSE, Henri, 1940, « Le milieu historique et artistique », Initiation au Maroc, Institut des Hautes Études Marocaines, Les Éditions d'Art et d'Histoire, p.43-97.
TERRASSE, Henri, 1950, « Trois bains mérinides du Maroc », in Mélanges offerts à William Marçais, Paris, G.-P. Maisonneuve p.311-320.
THOUVENOT, Raymond, 1949, « Sarcophage chrétien découvert à Rabat », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 93 (3), p.237-243.
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1949_num_93_3_78420
THOUVENOT, Raymond et DELPY, Alexandre, 1953, « Sépultures romaines à Rabat », Hespéris, XL, p.539-546.
http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1959-1950/128-hesperis-tamuda-1953
TISSOT, Charles-Joseph, 1876, « Itinéraire de Tanger à Rbat’ », Bulletin de la Société de Géographie, sixième série, tome douzième, p.225-294.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1038731
TISSOT, Charles-Joseph, 1877, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie tingitane, Paris, Imprimerie Nationale.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105862v.image