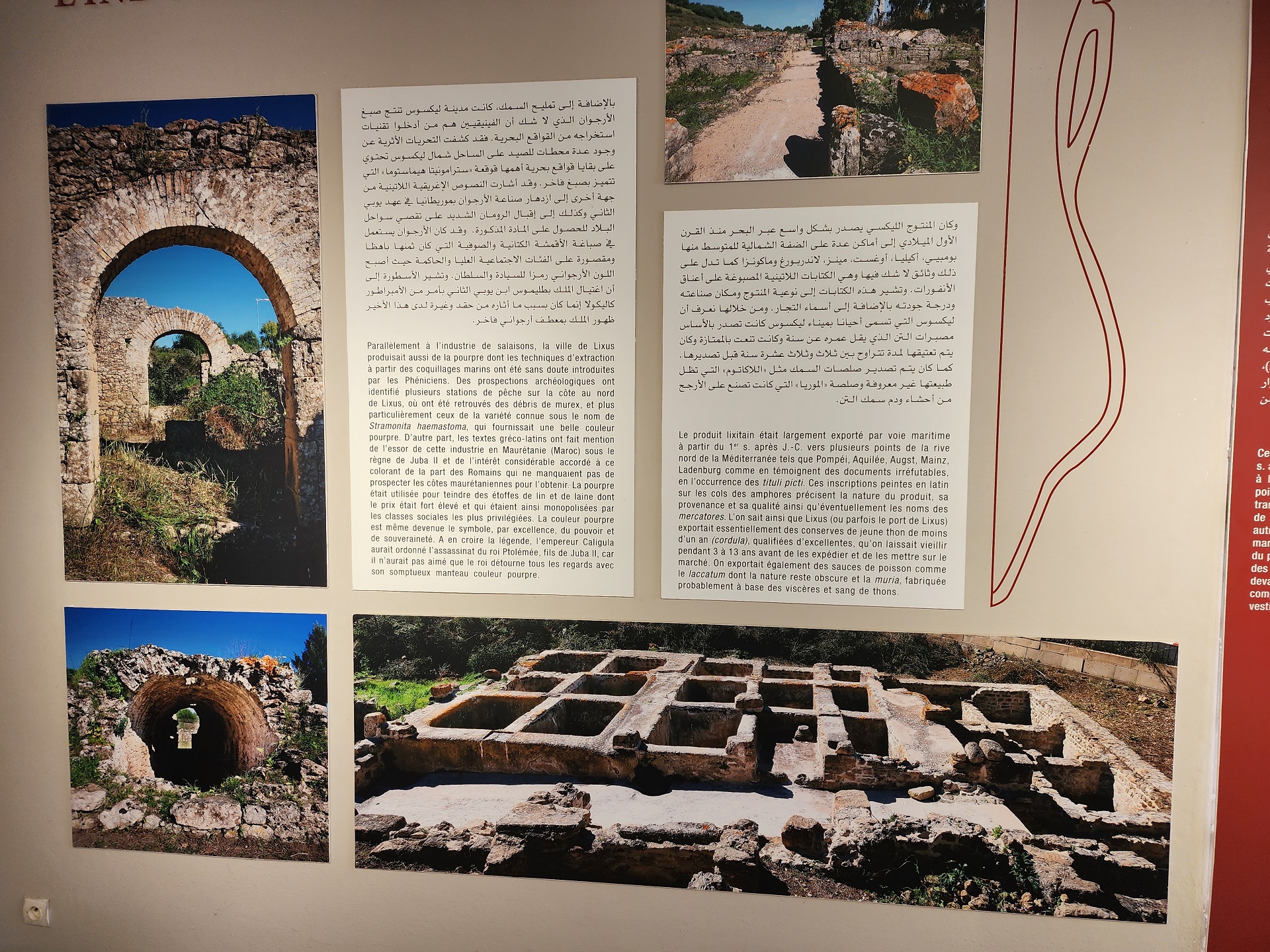Lixus

Webmaster
Histoire de la recherche à Sijilmâsa
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la localisation de l’ancienne cité caravanière demeure imprécise (Reinaud 1848). Il faut attendre la publication d’un mémoire du lieutenant-colonel de l’armée française Hyacinthe Dastugue, accompagné d’une première cartographie très complète du Tafilalet, pour identifier définitivement la ville (Dastugue 1867). En 1936, Henri Terrasse publie une note sur les ruines de Sijilmâsa, en particulier la zone de Médinat el Hamra, c’est-à-dire ce que l’on considère de nos jours comme la zone archéologique (Terrasse 1936). Quelques années plus tard, Vincent Monteil renseigne différentes observations sur le site et son arrière-pays à la suite de son séjour d’août à octobre 1940. Il s’accorde notamment avec Terrasse pour estimer que les ruines visibles ne constituent qu’une faible partie de l’ancienne cité (Monteil 1968). De son côté, l’ethnologue Djinn Jacques-Meunié, spécialiste du Maroc saharien qui s’intéressa aux décors et à l’architecture du Tafilalet, déclare que Sijilmâsa n’est plus qu’un amas de ruines d’une ville anciennement ravagée par les crues de l’Oued Ziz (Jacques-Meunié 1962). Les premiers véritables travaux archéologiques sur le site de Sijilmâsa ont été pratiqués dans les années 1970 par le Service des Antiquités du Maroc et ont consisté en une série de longues et profondes tranchées, encore nettement visibles sur le terrain à l’heure actuelle (Fauvelle et al. 2014). Malheureusement, aucun rapport de ces travaux archéologiques n’a été produit ou conservé (Hassar-Benslimane 1986). En 1971 et 1972, l’égyptologue italien Boris de Rachewiltz effectua, pour le compte de la Fondazione Keimer, plusieurs interventions géophysiques et archéologiques à la fois sur le site même de Sijilmâsa, mais aussi à un kilomètre au nord de la seguia Chorfa. Parmi les vestiges découverts, essentiellement de nature hydraulique, l’équipe de Rachewiltz observa par exemple un système de vases communicants ravitaillant en eau quatre petits puits quadrangulaires, une canalisation à ciel ouvert destinée à la récolte des eaux usées ou de pluie, liée à une canalisation souterraine, un système qui se retrouve encore à notre époque dans le noyau urbain de Rissani et qui conduit Rachewiltz à attribuer à ce secteur une fonction d’habitat (Rachewiltz 1972). Bien que cette publication mette en lumière le fort potentiel archéologique de cette zone, l’absence de données métriques et stratigraphiques ou d’études du mobilier n’offre aucun élément de datation. Pour l’heure, les données disponibles renvoient ces structures à une période indistincte pouvant aller de l’époque médiévale au début du XXe siècle (Soubira 2018). A partir de 1988, une équipe américaine dirigée par Ronald Messier, sous l’égide de la Middle Tennessee State University, effectua entre 1988 et1998 plusieurs campagnes sur le site de Sijilmâsa. Au total, une cinquantaine de sondages d’emprises relativement limitées (entre 6 et 15 m2) a été réalisée sur l’ensemble de la zone archéologique, la réunion de plusieurs sondages amenant à l’ouverture de secteurs plus vastes, en particulier à l’emplacement de la « mosquée » de Sijilmâsa et à l’ouest de cette dernière. Les résultats de ces fouilles maroco-américaines ont fait l’objet de nombreuses publications dont une monographie (Messier et Miller 2015 ; Fauvelle 2017).
Thomas Soubira, janvier 2020
Sijilmâsa dans son paysage
La zone archéologique est relativement vierge d’occupations récentes, hormis quelques infrastructures modernes (terrain de football, gare, caserne, école…) situées le long de la route d’accès à Rissani qui partage la zone en deux. Les vestiges archéologiques ne sont pas uniformément répartis. Des prospections systématiques ont montré qu’ils se concentrent du côté nord de la route sur environ un kilomètre et sur trois cents à quatre cents mètres du côté sud. Le site ne doit donc pas son apparence préservée au fait d’être une réserve archéologique, mais bien plutôt au fait qu’il constitue aujourd’hui, en cet endroit de la vallée du Ziz, la plaine d’inondation de l’oued, ainsi que le confirment nombre de témoins de crues récentes. Le site est par ailleurs couramment employé comme décharge publique et comme zone de prélèvement de sable éolien destiné à la fabrication de béton pour les infrastructures modernes. La morphologie des environs immédiats du site est aujourd’hui remarquablement plane. Les cours d’eau sont à peine inscrits en contrebas de la surface topographique et les rares éminences sont toutes d’origine anthropique.
Sijilmâsa dans l'histoire
Sijilmâsa fut fondée, d’après les sources arabes, par la tribu Miknâsa au milieu du VIIIe siècle de n. è., aux dépens de plusieurs établissements antérieurs, puis elle fut dominée par la tribu berbère des Banû Midrâr qui en fit un émirat kharidjite sufrite indépendant.
Sijilmâsa aujourd'hui
Sijilmâsa est un site majeur tant pour l’histoire de l’Afrique que pour l’histoire économique et politique du monde méditerranéen médiéval. Première « porte » pour la traversée du Sahara et principal entrepôt du commerce transsaharien, la ville de Sijilmâsa fut le principal marché de l’or soudanais entre le VIIIe et le XVe siècle ainsi que le siège des grandes maisons de commerce arabes et juives, à la périphérie des grandes dynasties du Maghreb médiéval. Le site de Sijilmâsa est situé au cœur de l’oasis du Tafilalet, qui fait partie de la région de Drâa-Tafilalet (dont le chef-lieu est Errachidia), dans les marges présahariennes du Maroc actuel. Les vestiges de l’ancienne cité caravanière sont parsemés sur un vaste terrain vague bordé, à l’ouest par le lit de l’Oued Ziz, et à l’est par la séguia Chorfa (canal dérivé de l’oued) qui ourle les faubourgs de la ville moderne de Rissani, sur une surface d’environ 110 ha (Daussy et al., 2015).
Sigilmassa : The City of Gold
Film « Sigilmassa : The City of Gold » (1971) réalisé par Boris de Rachewiltz sous le patronage de l’UNESCO.
Dans sa version originale, aimablement communiquée par Siegfried de Rachewiltz, le film dure 47 min, nous en présentons, ici, des extraits (montage réalisé par C. Gutron en 2018).