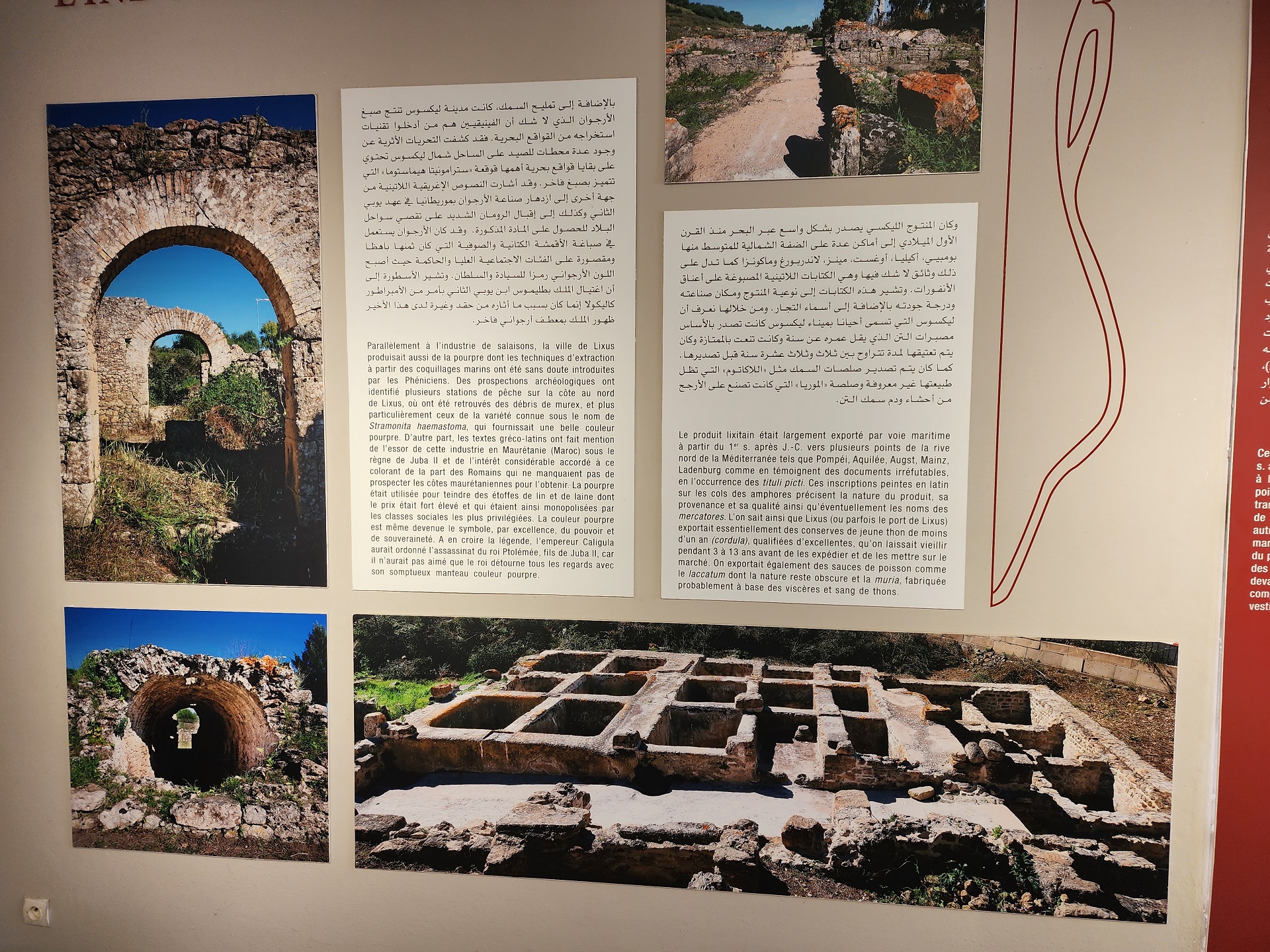Lixus

Webmaster
Tipasa aujourd’hui
Ancien comptoir punique devenu colonie romaine, le site de Tipasa est situé sur la côte méditerranéenne, à 70 km à l’ouest d’Alger et à 30 kilomètres à l’est de Cherchell (l’antique Caesarea). Au milieu du XIXe siècle, le pouvoir colonial établit un village de colonisation sur l’emprise de la ville antique au sud du port actuel ; la ville moderne s’est développée au sud de ce dernier, en préservant relativement bien les monuments emblématiques du site archéologique, parc national depuis 1949. Trois ensembles archéologiques peuvent être distingués : deux de part et d’autre du port, à savoir à l’ouest les installations urbaines (habitat, bâtiments publics, lieux de divertissement, etc.) et une zone principalement funéraire à l’est, ainsi que le Mausolée royal de Maurétanie dit Tombeau de la Chrétienne situé à une dizaine de kilomètres à l’est de la ville. Le musée de Tipasa abrite depuis 1955 les collections archéologiques issues des fouilles réalisées sur le site, plus particulièrement celles des diverses nécropoles préromaines, romaines et chrétiennes. Sont exposés entre autres le mobilier céramique et la verrerie, des mosaïques et des sarcophages. Reconnu comme un complexe archéologique exceptionnel permettant une meilleure connaissance des liens entre les civilisations locales et les populations issues des différentes vagues de colonisation entre le VIe siècle avant notre ère et le VIe s. de notre ère, le site de Tipasa a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982. Vingt ans plus tard, en 2002, du fait de la menace d’un développement urbain incontrôlé et de problèmes cadastraux (les trois sites classés patrimoine mondial n’étaient pas circonscrits), Tipasa fut placé sur la liste du patrimoine mondial en péril. Félicitant l’État algérien pour les actions engagées pour améliorer la protection du site, le Comité du patrimoine mondial a décidé en 2006 de retirer Tipasa de cette liste. Comptant relativement peu de visiteurs étrangers, le site est en revanche très fréquenté par les riverains et les Algérois qui aiment flâner au cœur des ruines antiques en bord de mer. La beauté des lieux a notamment été immortalisée dans le célèbre essai Noces d’Albert Camus ; une stèle a d’ailleurs été érigée sur le site en hommage à l’écrivain.
Tipasa constitue par ailleurs comme un pôle privilégié pour la recherche. Le Laboratoire d’Études Historiques et Archéologiques (LEHA) a ainsi été créé en 2020 au Centre universitaire de Morsli Abdellah. En 2021, a été inauguré le vaste Complexe algérien d’archéologie (CAA) qui rassemble l’École Nationale de Conservation et Restauration des Biens Culturels (ENCRBC), le Centre National de Recherche en Archéologie (CNRA) et l’Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens Protégés (OGEBC).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, mai 2021)
Bibliographie
AOUNALLAH Samir, BROUQUIER-REDDÉ Véronique, BONIFAY Michel, CHERIF Ali, HADDED Fatma, DE LARMINAT, Solenn, MUKAI, Tomoo et Poupon, Frédéric 2020a, « L’ensemble funéraire romain de la nécropole du Nord-Ouest à Dougga », Antiquités Africaines, 56, p. 221-244.
https://journals.openedition.org/antafr/2957
AOUNALLAH Samir, BROUQUIER-REDDÉ Véronique, ABIDI Haythem, ARTRU Jérémy, BEN SLIMÈNE Hanène, MALIGRONE Yvan, SGHAÏER Yamen et TOUJ Fatma, 2020b, « Architecture et pratiques funéraires préromaines dans la nécropole du Nord-Ouest à Dougga », Antiquités Africaines, 56, p. 183-205.
https://journals.openedition.org/antafr/2932
BACHA, Myriam, 2009, « La constitution d’une notion patrimoniale en Tunisie, XIXe-XXe siècles », dans BADUEL Pierre Robert (dir.), Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis, Paris, IRMC-Karthala.
BAKLOUTI, Habib, 2008, « L’alimentation en eau de Dougga (Thugga) : sources, aqueducs et réservoirs publics », Africa XXII, p. 139‐176.
BERGER, Philippe, 1904, « Découverte à Dougga (Tunisie) d’une inscription dédicatoire d’un temple élevé en l’honneur de Massinissa ». Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 48 (4), p. 406‐407.
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1904_num_48_4_19857
CARTON, Louis, 1904, « Le théâtre romain de Dougga », Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France, 11, p. 79-191.
https://www.persee.fr/doc/mesav_0398-3587_1904_num_11_2_1087
CARTON, Louis, 1910, Thugga. Ruines de Dougga, Tunis, L. Niérat et A. Fortin.
GOLVIN, Jean-Claude, 2020, L’Antiquité retrouvée, Arles, Errance, p. 117-119.
GOLVIN, Jean-Claude, KHANOUSSI, Mustapha, 2005, Dougga. Études d’architecture religieuse : les sanctuaires des Victoires de Caracalla, de « Pluton » et de Caelestis, Bordeaux, éditions Ausonius.
GROS, Pierre, 1996, L'architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, tome 1 : Monuments publics, Paris, Picard.
GUTRON, Clémentine, 2010, L’archéologie en Tunisie (XIXe-XXe siècles). Jeux généalogiques sur l’Antiquité, Paris-Tunis, Karthala-IRMC, chapitre 4.
GUTRON, Clémentine, 2016, « Mémoire (inter)nationale vs mémoire locale ? Enquête sur Dougga, un site archéologique tunisien du patrimoine mondial de l’humanité », in D. Guillaud, D. Juhé-Beaulaton, M.-C. Cormier-Salem et Y. Girault (eds), Ambivalences patrimoniales au Sud : mises en scène et jeux d’acteurs, Karthala/IRD, p. 121-138.
KHANOUSSI, Mustapha, 1980, Dougga. Collection Sites et monuments de Tunisie, Tunis, Ministère de la Culture.
KHANOUSSI Mustapha, 1994, « Thugga (Dougga) sous le Haut-Empire : une ville double ? », L’Africa Romana, X, p. 597-602.
KHANOUSSI, Mustapha, 1995, « Dougga, une cité numide et romaine », Les dossiers d’archéologie, 200, p. 123-124.
KHANOUSSI, Mustapha et MAURIN, Louis (dir.), 1997, Dougga (Thugga). Études épigraphiques, Bordeaux, Ausonius.
KHANOUSSI, Mustapha et MAURIN, Louis (dir.), 2002, Mourir à Dougga. Recueil des inscriptions funéraires, Bordeaux, Ausonius.
KHANOUSSI, Mustapha, 2003a, « Le temple de la Victoire germanique de Caracalla à Dougga », dans Coll. L'Afrique du Nord antique et médiévale : actes du VIIIe colloque d'archéologie et d'histoire de l'Afrique du Nord (8-13 mai 2000 à Tabarka), Tunis, p. 447- ?
KHANOUSSI, Mustapha, 2003b, « L'évolution urbaine de Thugga (Dougga) en Afrique proconsulaire : de l'agglomération numide à la ville africo-romaine », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 147 (1).
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2003_num_147_1_22547
KHANOUSSI, Mustapha, RITTER, Stefan et VON RUMMEL, Philipp, 2004. « The German-Tunisian Project at Dougga : First Results of the Excavations South of the Maison Du Trifolium », Antiquités Africaines 40 (1), p. 43‐66.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_2004_num_40_1_1386
LARONDE, André et GOLVIN, Jean-Claude, 2001, L’Afrique antique. Histoire et monuments. Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris, Tallandier, p. 126-129.
POINSSOT, Claude, 1983, Les Ruines de Dougga, Tunis, Ministère des Affaires Culturelles.
POINSSOT, Louis, 1901, « Les ruines de Thugga et de Thignica au XVIIe siècle, lu dans les séances du 24 décembre et du 7 janvier 1903 », Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, 42, p. 145-184.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4082523
POINSSOT, Louis, 1906, « Communication sur la Rose des Vents de Dougga », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, p. 297-298.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k206862b?rk=21459;2
RAMPAL, Auguste, 1917, « La correspondance de Barbarie de J.-A. Peyssonnel et le but véritable de son voyage (1724-1725) », Revue Tunisienne, 24 (124), p. 388-399.
SAINT-AMANS, Sophie, 2004, Topographie religieuse de Thugga (Dougga) : Ville romaine d’Afrique proconsulaire (Tunisie), Pessac, Ausonius Éditions.
https://books.openedition.org/ausonius/7893?lang=fr
SALAMA, Pierre, 1948, « Le réseau routier de l'Afrique romaine ». Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 92 (3), p. 395-399.
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1948_num_92_3_78300
Les recherches les plus récentes ou en cours
La transformation du site en parc archéologique national en 1991 permit de relancer la recherche, à une époque où la Tunisie s’efforçait également de développer ses infrastructures touristiques. Dès lors, plusieurs programmes internationaux se succédèrent à Dougga, des équipes pluridisciplinaires travaillant sur le terrain et proposant études et inventaires précis des vestiges. A partir de 1993, l’INP de Tunisie et le laboratoire Ausonius de l’université Bordeaux III collaborèrent au projet « Petrae-Thugga » afin de rassembler, étudier et créer un corpus informatique des inscriptions et textes de la ville, aboutissant à deux publications majeures (Khanoussi et Maurin, 1997 et 2002). En 1999, ces deux institutions poursuivirent leur collaboration avec un nouveau programme baptisé « Architecture religieuse païenne de Thugga », dédié à l’étude des temples et sanctuaires recensés sur le site, sous la direction de Mustapha Khanoussi et Jean-Claude Golvin (Golvin et Khanoussi, 2005). La même année, l’INP dépêcha une équipe afin de réaliser un premier relevé topographique, d’abord à l’est où devait s’élever un futur centre d’interprétation. Puis, en collaboration avec la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (France), les relevés se succédèrent de 2002 à 2006. De 1998 à 2000, Habib Baklouti conduisit les fouilles et l’étude des citernes publiques de Aïn ed-Doura, effectuant une prospection et un relevé architectural des installations hydrauliques, tandis que Mansour Ghaki dégageait au nord-ouest du site des bazinas (« buttes », tombes préislamiques typiques d’Afrique du Nord) entre 1996 et 2002 (Aounallah et al., 2020b). Entre 2001 et 2004, une mission germano-tunisienne (INP de Tunisie et l’Archäologisches Institut de l’université Albert-Ludwig de Fribourg) s’intéressa plus particulièrement à la maison du Trifolium (Khanoussi et al., 2004). Cet intérêt pour l’architecture domestique se retrouve dans les restitutions en 3D de la maison de Vénus et de celle d’Ulysse et Dionysos réalisées par Hazar Souissi et Najoua Tobji en 2006. Entre 2002 et 2007, un projet franco-tunisien intitulé « Dougga et sa région » financé par le ministère français des Affaires étrangères a donné lieu à des travaux d’ordre scientifique et patrimonial, avec un plan de mise en valeur du site, la formation de gestionnaires et d’artisans tunisiens, et enfin son intégration dans les circuits touristiques. Les équipes ont travaillé sous la direction de Mustapha Khanoussi et Denis Lesage, puis d’Aïcha Ben Abed et Jean-Claude Golvin. Depuis 2017, une fouille tuniso-française s’intéresse aux nécropoles du nord-ouest, composées à la fois de mégalithes et de tombes romaines, et au sanctuaire de Baal-Hammon Saturne au nord-est (PHC Utique « Dougga, de l’agglomération numide à la colonie romaine : dynamiques urbaines », co-dirigé par Samir Aounallah (INP) et Véronique Brouquier-Reddé (AOROC). Un dossier paru sur Dougga dans Antiquités Africaines en 2020 a livré les premiers résultats. La direction prise par les études des vingt dernières années indique ainsi un intérêt particulier pour les premiers temps de la ville et l’urbanisme romain, deux champs d’étude prometteurs sur un site tel que Dougga.
(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, juin 2021)
Histoire de la recherche à Dougga
Dès le XVIIe siècle, de nombreux voyageurs (érudits, diplomates, religieux) visitèrent le site et décrivirent les principaux monuments demeurés visibles depuis l’Antiquité : le Capitole, l’arc de Sévère Alexandre et le mausolée libyco-punique. C’est à la même période que les montagnards du Djebel Ousselet, qui refusaient de payer l’impôt et pillaient régulièrement le centre de la Tunisie, furent déplacés par décision du Bey et s’installèrent à Dougga dont les ruines servent de carrières de pierre. En 1842, le consul anglais Thomas Reade préleva (non sans causer de dégâts au monument) l’inscription bilingue du mausolée libyco-punique ; elle est aujourd’hui conservée au British Museum (numéro d’inventaire 125225). En 1862, Victor Guérin effectua un repérage des vestiges archéologiques. Vingt ans plus tard, la première mission officielle sur place fut menée par Marius Boyé et deux épigraphistes, Julien Poinssot et René Cagnat (Saint-Amans, 2004). En 1885, Henri Saladin dressa un inventaire complet du site, effectua les premiers sondages et étudia plus en détail le Capitole (Bacha, 2009). Suite à la création du Service Beylical des Antiquités de Tunisie en 1885, des autorisations de fouilles furent accordées à Louis Carton accompagné par Charles Denis. Ces derniers, entre 1891 et 1893, dégagèrent le théâtre et le sanctuaire de Saturne sur l’éperon est de la zone, tandis qu’en 1894, Eugène Sadoux et Onésime Pradère mirent au jour le temple de Caelestis, fouille poursuivie en 1895 par René Coudray de La Blanchère, puis par Jean Hilaire entre 1896 et 1897. En 1901, le site fut confié à Alfred Merlin qui déblaya le centre de la ville jusqu’au Dar Lachheb, avant de céder la place à Louis Poinssot en 1903. Durant trois décennies, celui-ci dégagea le forum (1910-1915), le temple de Tellus (1917-1918), ainsi que plusieurs maisons (1910-1920). À partir de 1919, le manque de subsides et l’intérêt croissant porté à d’autres sites archéologiques ralentirent les travaux. Les thermes antoniniens furent dégagés en 1925, mais les fouilles s’arrêtèrent en 1932. Il semble que Claude Poinssot (le fils de Louis) pratiqua quelques sondages dans le temple de Saturne et le Capitole dans les années 1950, mais les résultats ne furent guère publiés. Suite à l’indépendance du pays en 1956 et malgré de faibles crédits, les fouilles reprirent un an plus tard sous l’autorité de Mongi Boulouednine, membre de l’Institut National d’Archéologie et d’Art nouvellement créé. Ces travaux archéologiques dégagèrent des quartiers d’habitations au nord du Capitole et à l’est du Dar Lachheb, notamment la maison de Vénus ou encore le temple des Victoires de Caracalla (Saint-Amans, 2004). Ces chantiers fonctionnèrent jusqu’en 1962 et, malheureusement, les résultats ne furent jamais publiés. Ce furent les dernières recherches d’ampleur sur le site, jusqu’aux années 1990.
(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, juin 2021)
Dougga dans son paysage
Le site de Dougga réunit toutes les conditions pour une implantation humaine dès les hautes époques, se trouvant au centre d’un ensemble géographique particulièrement fertile : la vallée de l’Oued Khaled et celle de l’Oued Arko, la plaine du Krib ou encore le pays du Belad Zehna (Carton, 1910). Deux montagnes boisées sont proches du site : le Jebel Echhid à 15 km et le Bou Khobza à 20 km. C’est donc un paysage montagneux faits de vallons et de plateaux – parfaits pour l’extraction de la pierre, dont un calcaire gris-jaune caractéristique. Les températures plus fraîches que dans les régions plus méridionales ont permis à de larges prairies de s’étendre. Le sol est varié et fertile, permettant aux champs, aux vergers et aux oliveraies de donner une production abondante chaque année. La présence de sources d’eau douce a permis l’irrigation des champs et l’alimentation de la ville antique via des aqueducs et des citernes (Baklouti, 2008). La ville se place sur la pointe d’un promontoire qui protège le site à la fois des vents et des attaques ennemies. De plus, la cité est proche d’un réseau de routes commerciales majeures conduisant vers les grandes cités côtières telle que Carthage (Salama, 1948). En raison de la nature escarpée du site, la ville s’est construite progressivement en descendant le long de la pente. Le tracé des rues est donc irrégulier, bien loin du schéma orthonormé romain. Le forum est bien visible, au centre de la ville, autour duquel se développèrent des quartiers d’habitations sous forme d’îlots. Deux grandes portes marquent les entrées de la cité : la porte de Septime Sévère au sud sur la route du Kef (en 205) et la porte d’Alexandre Sévère (en 232) à l’ouest du forum. Des traces des implantations anciennes subsistent. La nécropole mégalithique, signalée par des dolmens, occupe la partie nord du site, entre la muraille et le bord de la falaise (Anouallah et al., 2020). Le célèbre mausolée libyco-punique (« mausolée d’Atban », fin du IIIe / début du IIe siècle avant notre ère) se dresse au bas de la pente à l’extrémité sud du site. Sur le forum, la découverte d’une inscription bilingue au nom de Massinissa laisse supposer l’existence d’un ancien temple construit au pied du futur Capitole, dans la partie est du forum, qui fut remplacé par un arc monumental sous le règne de Tibère (en 36-37) (Berger, 1904). Le Capitole, dédié à Jupiter, Junon et Minerve, est le monument le mieux conservé du site. Construit sous Marc-Aurèle (166-167), son fronton encore en place représente l’apothéose de l’empereur Antonin le Pieux enlevé par un aigle (Golvin, 2020). Deux places, l’une oblongue et l’autre carrée, furent construites dans le prolongement l’une de l’autre, respectivement à l’ouest et à l’est du Capitole (Golvin, 2020). La place oblongue est entièrement dallée, bordée par un portique sur trois côtés, et elle dispose d’une tribune aux harangues. Tout proche, le temple de la Fortune fut restauré sous Sévère Alexandre (entre 222 et 235). La partie sud est occupée par le temple de Liber Pater et des temples de la Concorde. Au Ve siècle, face au Capitole, une basilique décorée de mosaïques blanches fut construite. A l’est de la grande place du forum, une seconde place fut bâtie sous le règne de Commode (180-192) ; elle fut baptisée « Place de la Rose des Vents » d’après la gravure d’une rosace à douze rayons sur le dallage (Poinssot, 1906). Au nord de celle-ci, collé au Capitole, se trouve le temple de Mercure, et à l’est, le temple de la Piété Auguste. Au sud de cette place, deux entrées menaient au marché, bordé par des petites boutiques et dont la place était ornée d’une fontaine. De nombreuses dédicaces découvertes dans la cité indiquent la présence d’au moins neuf autres temples et près de trente sanctuaires, majoritairement concentrés autour du Forum. Signalons aussi la présence d’un temple de Minerve au nord du site, près des dolmens, et d’un temple dédié à Baal-Hammon Saturne sur l’éperon rocheux à l’est. À la périphérie de la ville, à l’ouest de la porte d’Alexandre Sévère, le temple de Junon Caelestis se dresse sur un podium, le téménos dans son ensemble prenant une forme semi-circulaire (Gros, 1996). Deux monuments de spectacles sont toujours visibles : à l’extrémité nord, juste à côté du temple de Minerve, un cirque sommaire où se déroulaient des courses de char fut construit au IIIe siècle grâce à une donation de Gabinia Hermiona. La longueur de la piste était de 300 m pour une largeur de 65 mètres environ, avec douze stalles de départ des chars bâties au nord (Golvin, 2020). Mais c’est surtout le théâtre (datant de 168-169 selon toute vraisemblance), au sud de l’éperon rocheux, qui est dans un bien meilleur état de conservation. La très forte pente fut utilisée pour l’implantation des gradins, pouvant accueillir un maximum de 3500 spectateurs. Le mur de scène était décoré de colonnes d’ordre corinthien ; trois portes reliaient la scène au portique postérieur, et deux salles couvertes sont présentes de part et d’autre du bâtiment de scène (Carton, 1904 ; Laronde et Golvin, 2001). Trois thermes furent dégagés. Ils sont localisés au sud du site : les thermes antoniens (ou de Caracalla) au sud-est du forum, les thermes des Cyclopes non loin de là au sud-est, et enfin les thermes d’Aïn Doura (fin IIe/début IIIe siècle), plus éloignés au sud et qui n’ont, à ce jour, fait l’objet que de fouilles partielles. Un aqueduc long de 200 m conduisait les eaux de la source d’Aïn Mizeb jusque dans les citernes bâties du sud du temple de Minerve au nord du site. Un autre, plus long, allait chercher l’eau de la source d’Aïn el-Hammam à 12 km à l’ouest pour remplir divers réservoir et citernes, dont celles proches des thermes d’Aïn Doura (Khanoussi, 1980). Concernant les demeures, on en compte une trentaine à l’heure actuelle. Celles qui entourent le forum, modestes et avec un étage, furent édifiées au IIIe siècle de notre ère. Les villas sont plus rares, trois d’entre elles sont remarquables : la maison du Trifolium (proche des thermes des Cyclopes) d’une superficie de 800 m2 (Khanoussi et al., 2004), la maison d’Ulysse et de Dionysos (dont les mosaïques sont conservées au Bardo) près des thermes antoniens, ou encore la maison de Vénus, située entre le temple de la Victoire de Caracalla et le temple anonyme (surnommé le Dar Lachheb, la « Maison de Lachheb ») au sud-ouest du forum. Concernant les monuments de l’époque byzantine, on compte la petite église de Victoria, en contrebas du temple de Baal-Hammon Saturne, ainsi que les restes d’une forteresse bâtie sur le forum et d’où partait une enceinte entourant la partie nord-est du site jusqu’au théâtre.
(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, juin 2021)
Dougga dans l’histoire
Deux hypothèses ont été avancées au sujet de l’origine du nom de l’antique Thugga, qui serait issu soit du nom numide / berbère « Tukka » (« roc à pic »), en référence à la falaise qui borde le site, soit de « Thukka » (« pâturages »), en lien avec les prairies fertiles environnantes (Carton, 1910 ; Poinssot, 1983). Les premières traces humaines décelables sur le site semblent remonter au milieu du IIe millénaire avant notre ère, matérialisées par la présence d’un mur d’enceinte mégalithique et de dolmens au nord du site, entre la muraille et le bord de la falaise (Aounallah et al., 2020). La fondation de la ville pourrait remonter au VIe siècle avant notre ère (Khanoussi, 2003a). À la fin du IVe siècle avant notre ère, Enmachus, lieutenant d’Agathocle de Syracuse, s’empare de la cité qui est déjà, selon Diodore de Sicile, « de belle grandeur ». Au cours de la première moitié du IIe siècle avant notre ère, elle tombe dans le giron du roi numide Massinissa et devient l’une de ses résidences royales (Khanoussi, 1994 et 1995). Plusieurs monuments libyco-puniques sont attestés : la nécropole, un mausolée et des temples (dont l’un dédié à Baal-Hammon Saturne) (Khanoussi, 2003b). Après la destruction de Carthage par les Romains en 146 avant notre ère, Thugga reste hors de la Province Romaine d’Afrique, et ce jusqu’en 46 avant notre ère après la défaite du roi numide Juba Ier. La ville devient alors romaine ; les premiers travaux de construction, notamment l’aménagement du quartier du forum, débutent au Ier siècle de notre ère (Khanoussi, 2003b). La ville se couvre de monuments : des sanctuaires (l’un est dédié à Minerve), un grand ensemble de temples (dédiés à la Concorde, à Frugifer et à Liber Pater) et d’autres dédiés à la Victoire de l’empereur Caracalla ou encore à la déesse Caelestis. Un temple encore anonyme est aussi bâti (surnommé le Dar Lachheb, « la maison de Lachheb »), tout comme le Capitole et le théâtre. Sous Septime Sévère en 205, la ville obtient le rang de municipe, puis celui de colonie sous Gallien en 261. Entre 284 et 376 (de Dioclétien à Théodose l’Ancien), les inscriptions font mention de commémorations et de restaurations d’édifices. La religion chrétienne commence par ailleurs à s’implanter, comme le montre la construction d’une petite église dans l’ancien cimetière païen (Poinssot, 1983). En 411, Thugga envoie un évêque donatiste à une conférence tenue à Carthage. L’arrivée des Vandales de Genséric en 439 a sans doute touché la ville, mais l’absence de témoignages écrits empêche de connaître avec précision les changements survenus. Cependant, la disparition du représentant chrétien dans les comptes rendus des conciles des évêques africains laisse supposer le début de l’abandon de la ville (Khanoussi, 1980). Lors de la reconquête de l’Afrique par Justinien, en 533-534, des fortifications sont érigées sur les ordres du généralissime Solomon, englobant le forum et le capitole. Ce fort, construit à partir des pierres des édifices alors en place, mesurait une dizaine de mètres de hauteur. Il répondait aux besoins de la population locale de protection en cas de razzia. Au VIIe siècle, avec la conquête arabe, les habitants semblent camper dans des ruines puisque qu’aucune trace de réparation n’est retrouvée. Les petits bains au pied du mur sud de la forteresse byzantine, sans doute aghlabides, furent construits à cette période. Une petite communauté chrétienne semble toujours subsister (Poinssot, 1983). La destruction de Thugga fut probablement due à l’invasion hilalienne au Xe siècle, ce qui expliquerait aussi la construction de l’enceinte qui entoure une partie de la ville antique. Nous disposons de nombreux témoignages modernes au sujet de Dougga. Ainsi, un important groupe d’émigrés andalous s’installa à Dougga après l’expulsion définitive des musulmans d’Espagne par Philippe III en 1609. Le petit trésor découvert dans l’une des citernes du temple de Saturne (une trentaine de pièces d’argent du XVIe siècle) date de cette période (Poinssot, 1983). Peu à peu, la majeure partie de la ville se couvrit de végétation. La moderne Dougga devient alors une petite bourgade localisée au cœur de la ville antique, jusqu’au déplacement des habitants dans la « nouvelle Dougga ».
(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, juin 2021)
Dougga aujourd’hui
Les vestiges de l’antique Thugga sont situés dans le nord-ouest de la Tunisie, à environ 110 km au sud-ouest de Tunis. La cité, alimentée en eau par deux sources, s’est implantée dans la vallée fertile de l’oued Khaled, à la confluence de la Medjerda et de la Siliana. Perchée sur un plateau à 571 mètres de hauteur, elle est protégée par une falaise abrupte au nord et à l’est (la Kef Dougga) et surplombe une voie de circulation stratégique. Dougga fait aujourd’hui partie du gouvernorat de Béja et dépend de la délégation de Téboursouk, ville à 5 km de distance. Dougga est considéré l’un des sites archéologiques les plus exceptionnels d’Afrique du nord : sur une superficie d’environ 70 hectares, on y trouve les vestiges remarquablement bien conservés des civilisations libyque, punique, romaine et byzantine. Ces ruines ont fait l’objet de mesures de protection et de mise en valeur dès l’époque du Protectorat français en Tunisie (six décrets se succédèrent au gré des découvertes : décret du 8 juin 1891, du 23 décembre 1891, du 13 mars 1912, du 3 mars 1915, du 25 janvier 1922 et du 16 novembre 1928). En 1991, fut créé le Parc archéologique de Dougga (décision du 21 juillet 1991). Le site a été inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997. Il accueille de nombreux touristes nationaux et étrangers. Dans le théâtre romain restauré, se tient, chaque été, l’un des plus grands festivals musicaux du monde arabe. La population qui vivait au cœur des ruines au moment de l’exploration scientifique des lieux et de leur exploitation touristique fut déplacée dans les années 1960 dans une ville neuve baptisée Dougga al Jadida (« Dougga la nouvelle »), bâtie à quelques kilomètres au sud de la zone archéologique (Gutron, 2010, 2016).
(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, juin 2021)
Bibliographie
ALLAIS, Yvonne, 1933, « L’alimentation en eau d’une ville romaine d’Afrique, Cuicul (Djemila) », Cinquième Congrès International d'Archéologie, Alger (14-16 avril, 1930), Alger, Société Historique Algérienne.
ALLAIS, Yvonne, 1938, Djemila, Paris, Les Belles-Lettres.
ALLAIS, Yvonne, 1953, « Le quartier à l’est du Forum des Sévères », Revue Africaine, 97, p.48-65.
https://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm
ALLAIS, Yvonne, 1971, « Le quartier occidental de Djemila (Cuicul) », Antiquités Africaines, 5, p.95-120.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1971_num_5_1_921
BALLU, Albert, 1910, « Rapport sur les fouilles exécutées en 1909 par le Service des Monuments Historiques de l’Algérie », Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques,
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2033386
BALLU, Albert, 1921, « Ruines de Djemila (Antique Cuicul) », Revue Africaine, 62, p.201-274.
https://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/revue.htm
BALLU, Albert, 1926, Guide illustré de Djemila (Antique Cuicul), Alger, Jules Carbonel.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k320953q
BLANCHARD-LEMÉE, Michèle, 1975, Maisons à mosaïques du quartier central de Djemila (Cuicul), Paris, Etudes d’Antiquités Africaines.
https://www.persee.fr/doc/etaf_0768-2352_1975_mon_3_1
BLANCHARD-LEMÉE, Michèle, 1996, « Le Musée de Djemila (Algérie) ; historique et problèmes actuels », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 1994, p.87-103.
https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_1996_num_1994_1_9905
BLANCHARD-LEMÉE, Michèle, 1998, « Dans les jardins de Djemila », Antiquités africaines, 34, p.185-197.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1998_num_34_1_1295
DELAMARE, Adolphe, 1850, Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, 1843, 1844 et 1845, Paris, Imprimerie Nationale.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k664958
DUPUIS, Xavier, 2006, « Les origines de la colonie de Cuicul », Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, 2001, p.151-161.
https://www.persee.fr/doc/bsnaf_0081-1181_2006_num_2001_1_10521
DUREAU DE LA MALLE, Adolphe, 1838, Voyages dans les Régences de Tunis et d'Alger, Paris, Librairie De Cide.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103538m
FÉVRIER, Paul-Albert, 1996a, « Notes sur le développement urbain en Afrique du Nord. Les exemples comparés de Djemila et de Sétif », in P.-A. Février, La Méditerranée de Paul-Albert Février, recueil d’articles, Rome, Publications de l'École française de Rome, 225, p.651-697.
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1996_ant_225_1_5682
FÉVRIER, Paul-Albert, 1996b, « Aux origines de l'occupation romaine dans les hautes plaines de Sétif », in P.-A. Février, La Méditerranée de Paul-Albert Février, recueil d’articles, Rome, Publications de l'École française de Rome, 225, p.725-740.
https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_1996_ant_225_1_5685
FÉVRIER, Paul-Albert, BLANCHARD-LEMÉE, Michèle, 2019, L’édifice appelé « Maison de Bacchus » à Djemila, Paris, Etudes d’Antiquités Africaines.
GASCOU, Jacques, 1972, La politique municipale de l'empire romain en Afrique proconsulaire de Trajan à Septime Sévère, Rome, Publications de l'École française de Rome, 8.
https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1972_mon_8_1
GOLVIN, Jean-Claude, 2020, L’Antiquité retrouvée, Arles, Éditions Errance, p.135.
GSELL, Stéphane, 1901, Les monuments antiques de l’Algérie, tome I, Paris, Albert Fontemoing.
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/8653
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2003, « Le site archéologique de Djemila, éventail d’actions possibles », Dossiers d’archéologie, 286, p.26- 31.
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2006, « Djemila la perle des Babors », in Z. Bouzid, Universelle Algérie, les sites du patrimoine mondial, Alger, édition Zaki Bouzid.
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2006, Djemila l’antique Cuicul, joyau du patrimoine universel, Alger, Guides AdDiwan, Alger.
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2014, « La vie sociale à Djemila (Cuicul), documents archéologiques à caractère ludique », Volumen, 11-12, p.105- 126.
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2015, « Djemil, pour une valorisation du patrimoine », Ikosim, 4, p.67- 74
IKHERBANE, Mohand-Akli, 2015, « Djemila, contribution pour une valorisation du patrimoine (site archéologique de Djemila, Cuicul) », Athar, 12, p.4- 9.
KADRA Fatima Kadria, 1985, "Recherches et travaux en 1977-1979", Bulletin d'Archéologie Algérienne, tome VII, fasc. I.
KAEGI, Walter Emil, 2010, Muslim Expansion and Byzantine Collapse in North Africa, Cambridge, Cambridge University Press.
LASSUS, Jean, 1971, « La salle à sept absides de Djemila-Cuicul », Antiquités africaines, 5, p.193-207.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1971_num_5_1_927
MONCEAUX, Paul, 1920, « Martyrs de Djemila », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 64 (4), p.290-297.
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1920_num_64_4_74330
MONCEAUX, Paul, 1922, « Découverte d'un groupe d'édifices chrétiens à Djemila », Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 66-5, p.380-407.
https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1922_num_66_5_74681
NODIER, Charles, 1844, Journal de l'expédition des Portes de Fer, Paris, Imprimerie Royale.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k961712
OULEBSIR, Nabila, 1994, « La découverte des monuments de l'Algérie. Les missions d'Amable Ravoisié et d'Edmond Duthoit (1840-1880) », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, 73-74, p.57-76.
https://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1994_num_73_1_1667
RAVOISIÉ, Amable, 1846, Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841 et 1842, Paris, Firmin Didot Frères.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8595632
REBUFFAT, René, 1980, « Cuicul, le 21 juillet 365 », Antiquités Africaines, 15, p.309-328.
https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1980_num_15_1_1051
ROUSSET, Camille, 1887, L’Algérie de 1830 à 1840 : les commencements d’une conquête, tome second, Paris, Plon.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58289929
SAADOUI Dahia, Historiographie des fouilles effectuées sur le site archéologique de Cuicul-Djemila (Algérie), mémoire de M. 2, Université Bordeaux Montaigne, sous la direction de Sylvie Faravel, Anne Michel et Daniel Istria.
SHAW, Thomas, 1743, Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, tome I, La Haye, Jean Neaulme.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104727s
Les recherches les plus récentes ou en cours à Djemila
Michèle Blanchard-Lemée effectua en mai 1993, en exécution des accords de coopération archéologique franco-algériens de 1991 et 1992, une mission au musée de Djemila principalement axée sur la conservation des mosaïques (Blanchard-Lemée, 1996).
Depuis janvier 2020, le projet « Étude, conservation et valorisation du groupe épiscopal de Cuicul-Djemila (Algérie) » (EPICUR), co-dirigé par Daniel Istria (AMU-LA3M), Youcef Aibeche (Université de Sétif 2) et Aïcha Amina Malek (AOrOc), en partenariat avec le Laboratoire d’archéologie de l’Université de Sétif 2 et financé pour une durée de 36 mois par l’Agence Nationale de la Recherche. L’objectif du projet est de réétudier, par le biais des nouvelles technologies, le groupe épiscopal paléochrétien de Cuicul-Djemila, dégagé en totalité au XIXe et au début du XXe s. mais demeurant pourtant assez mal connu, et d’en assurer la conservation et la valorisation scientifique[1].
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)
Histoire de la recherche à Djemila
Le 15 juillet 1725, le médecin et naturaliste français Jean-André Peyssonnel évoqua rapidement, sans s’y arrêter, les ruines de « Gimili », correspondant aux débris d’un temple et de quelques vieilles masures, qu’il confond avec les ruines de l’ancien fort romain de Gemellae, que l’on situe en limite du Sahara à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Biskra (Dureau de la Malle, 1838). Dans le compte-rendu de son voyage dans la Régence d’Alger vers 1732, l’ecclésiastique anglais Thomas Shaw mentionna brièvement la ville de « Jimmeelah » où l’on trouve de beaux restes antiques d’une porte de la ville et d’un amphithéâtre, tout en reproduisant la même erreur d’identification que Peyssonnel (Shaw, 1743 ; Ravoisié, 1846). On doit vraisemblablement la bonne identification des ruines de Djemila à la Cuilcul antique lors de l’expédition française de Constantine du 1er au 10 octobre 1837. Le Duc d'Orléans campa sur le site le 20 octobre 1839 lors de l’expédition des Portes de Fer. Il décrit les matériaux de construction des principaux monuments visibles, dont l’arc de triomphe qu’il projette de démonter pour le transporter à Paris en le floquant de l’inscription « L’armée d’Afrique à la France ». L’ordre en fut donné, par une lettre du maréchal duc de Dalmatie du 10 décembre 1842, mais le maréchal Valée, opposé au projet, ajourna cette opération deux mois plus tard (Gsell, 1901 ; Ballu, 1921). C’est dans ce contexte qu’Amable Ravoisié réalisa les premières interventions archéologiques sur ce site, accidenté et vierge de toute installation moderne, du 18 juin au 22 juillet 1840 : un premier plan général de localisation des vestiges est dressé, des fouilles et des travaux ponctuels de consolidation et de restauration sont menés autour de divers monuments, accompagnés de relevés du bâti et d’une importante série d’inscriptions (Ravoisié, 1846 ; Delamare, 1850). Au milieu des années 1880, Edmond Duthoit, disciple d'Eugène Viollet-le-Duc nommé quelques années plus tôt architecte en chef des Monuments Historiques de l’Algérie, prit quelques mesures de consolidations de l’arc de triomphe. Son successeur, Albert Ballu, poursuivit ces travaux de consolidation sur ce monument et d’autres en 1900 et 1901, accompagnés de sondages ponctuels, notamment sur les thermes du secteur sud (Ballu, 1910, 1921 ; Oulebsir, 1994). Les fouilles méthodiques sur le site débutèrent véritablement en 1909 sous la responsabilité d’Albert Ballu. Les travaux réalisés dans la zone au sud du grand temple, ce dernier en partie déblayé, ont permis la découverte de la vaste et luxueuse Maison de l’Âne, en référence à une mosaïque qui recouvre l’hypocauste d’un complexe balnéaire où figure l’animal et l’inscription Asinus Nica, « l’âne vainqueur » (Ballu, 1910). Après une dizaine d’années de fouilles, la grande majorité des principaux bâtiments et l’urbanisme général de la cité ont été dégagés ; le matériel exhumé (mosaïques, textes épigraphiques, statues, petits objets …) est, dès 1910, exposé dans un musée au cœur du site archéologique (Ballu, 1921, 1926 ; Monceaux, 1922 ; Blanchard-Lemée, 1996). Madame de Crésolles, épouse d’un ancien administrateur colonial (décédé en 1917) et fille de M. de Saillan (mort en 1920) – tous deux inspecteurs des travaux du site dans la décennie 1910 – prend la direction des fouilles et du musée de Djémila de 1920 à sa mort en 1941 (Blanchard-Lemée, 1996). De 1942 à 1956, la direction des fouilles est confiée à Yvonne Allais, collaboratrice de Madame de Crésolles à Djémila depuis une quinzaine d’années et autrice de plusieurs publications dont un petit guide sur la cité romaine (Allais, 1938). Elle contribua grandement à la reconnaissance du site en dégageant les quartiers occidentaux et orientaux (Allais, 1953, 1971). De nouvelles recherches sont conduites dans les années 1960. Il s’agit de sondages archéologiques : d’abord en 1964, sous la direction de Paul-Albert Février, dans la « salle à sept absides » partiellement dégagée par Yvonne Allais, intégrant l’ensemble plus complexe de la luxueuse « Maison de Bacchus » ; ensuite en 1966, sous la direction de Roger Guéry et Michèle Blanchard-Lemée, dans la « Maison de l’Âne » (Lassus, 1971 ; Blanchard-Lemée, 1975 ; Février et Blanchard-Lemée, 2019). Blanchard-Lemée revint en septembre 1979, sur autorisation de la Direction des Musées, de l’Archéologie, des Monuments et Sites Historiques, afin d’effectuer les derniers relevés dans la même demeure (Kadra, 1985). Pour l’heure, en dépit de l’importante quantité de publications, il n’existe pas de réelle monographie générale regroupant de façon systématique l’ensemble des données des fouilles réalisées sur le site, en particulier les études du mobilier céramique, numismatique ou orfévré.
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer février 2021)