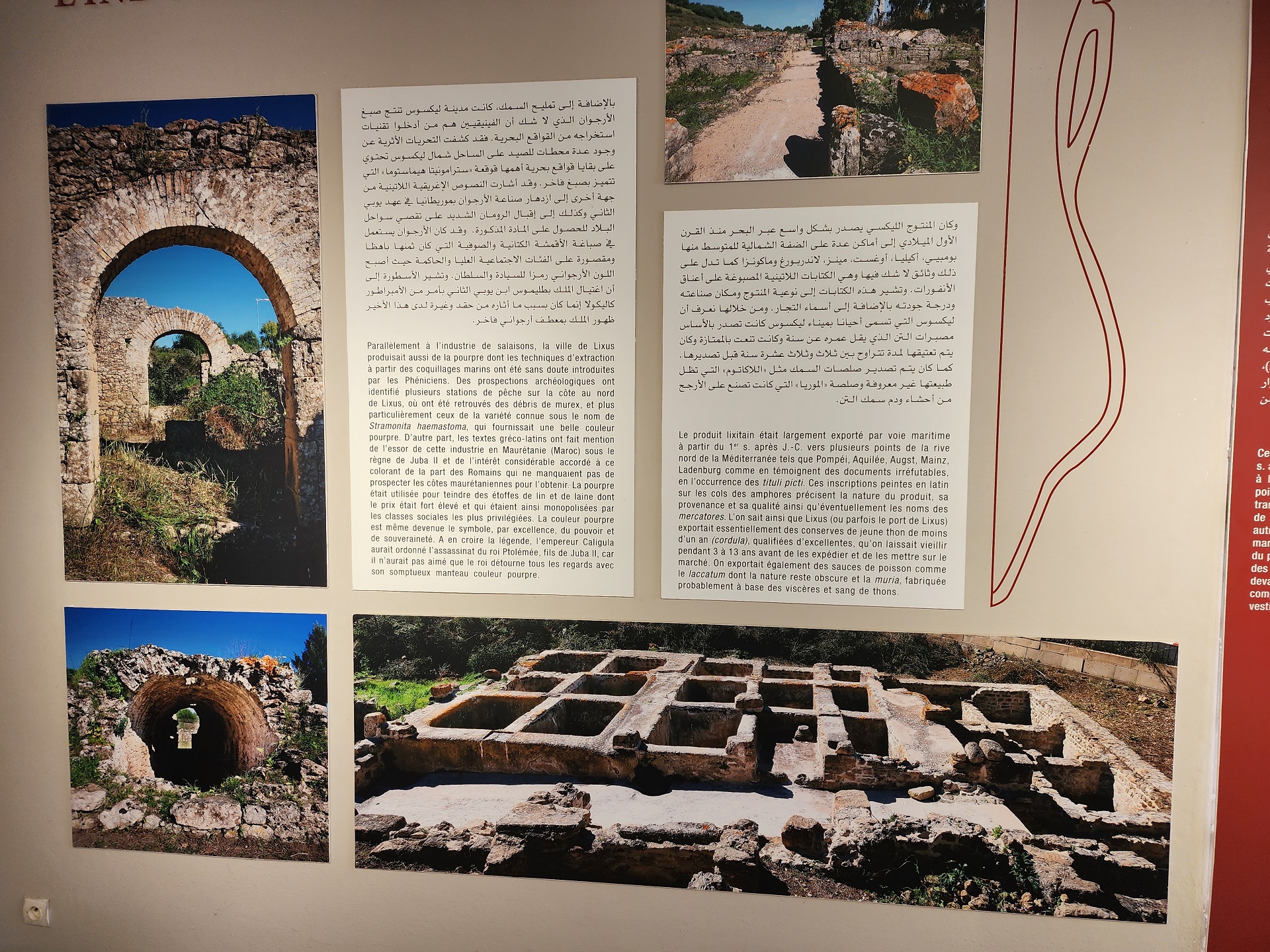Lixus

Webmaster
Références et bibliographie
BAKROBENA, Lebarama, 2015, Savoirs techniques des forgerons de Bitchabé (pays bassar, nord-Togo) : approche ethnoarchéologique, Mémoire de master en archéologie, Université de Lomé.
BAKROBENA, Lebarama, 2018, « Contribution à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine archéologique : le cas des vestiges sidérurgiques des forgerons bassar du Nord-Togo » dans la Revue Togolaise des Sciences de l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Etudes Togolaises, Vol 12, n°2 – Juillet – Décembre 2018 - ISSN 0531 – 2051 ; pp. 44-59.
BAKROBENA, Lebarama, 2021, Archéologie d’une communauté de sidérurgistes d’Afrique Subsaharienne : savoirs, techniques et histoire des forgerons de Bitchabé (pays bassar, nord-Togo), Thèse de Doctorat en Archéologie africaine, Université de Lomé.
Cornevin, Robert, 1962, Les Bassari du Nord-Togo, Paris, Berger-Levrault (« Mondes d'Outre-Mer »).
De Barros, Philip Lynton, 1985, The Bassar: large-scale iron producers of the West African savannah, Ph.D. dissertation, University of California.
De Barros, Philip Lynton,1986, « Bassar: A quantified, Chronologically, Controlled, Regional Approach to a Traditional Iron Production Centre in West Africa », Africa 56 (2), p. 148-174.
De Barros, Philip Lynton,1988, « Societal repercussions of the rise of large- scale traditional iron production: a West African example », The African Archaeological Review 6, p. 91-113.
De Barros, Philip Lynton, 2006, « Dekpassanware: early iron age site from the Bassar region of Northern Togo », in Actes du 18e Congrès de la Société des Archéologues Africanistes, Calgary. pXXX
De Barros, Philip Lynton, Iles, Louise, Frame, Lesley D., Killick, David, 2020, « The Early Iron Metallurgy of Bassar, Togo: furnaces, metallurgical remains and iron objects », Azania: Archaeological Research in Africa, 55 (1), p. 3-43.
De Barros, Philip Lynton, Lucidi, Gabrielle, 2016, « Is This an Anvil? Iron Bloom Crushing Sites in Northern Togo”, in K. Sadr, A. Esterhuysen and C. Sievers, African Archaeology Without Frontiers, Johannesburg, Wits University Press, p. 60-84.
Dugast, Stephan, 1986, « La pince et le soufflet : deux techniques de forge traditionnelles au Nord-Togo », Journal des Africanistes, 56 (2), p. 29-53.
Dugast, Stephan, 1992, Rites et organisation sociale : l'agglomération de Bassar au Nord-Togo, Thèse de doctorat, EHESS.
Dugast, Stephan, 1996, « Meurtriers, jumeaux et devins : trois variations sur le thème du double (Bassar, Togo) », Systèmes de pensée en Afrique noire 14, p. 175-209.
Dugast, Stephan, 2004, « Une agglomération très rurale. Lien clanique et lien territorial dans la ville de Bassar (Nord-Togo) », Journal des Africanistes 74 (1-2), p. 203-248.
Dugast, Stephan, 2009, « Le rite de tigiikaal pour les génies de marigot (Bassar du Togo) », in M. Cartry, J.-L.Durand et R. Koch Piettre, Architecturer l’invisible, Autels, ligatures, écritures, Turnhout, Brepols (« Bibliothèque de l’école des Hautes études, Sciences Religieuses » 138), p. 153-220.
Dugast Stephan, 2012, « Entre four et forge ou jusqu’à quel point efficacité magique et savoir technique sont-ils conciliables ? (Bassar du Togo) », in C. Robion-Brunner et B. Martinelli, Métallurgie du fer et Sociétés africaines. Bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et archéologique, Oxford, BAR International Series 2395 (« Cambridge Monographs in African Archaeology » 81), p. 97-123.
Dugast Stephan, 2013, « Des pierres pour travailler le fer : les outils lithiques des forgerons bassar du Nord-Togo. I. Techniques, nomenclatures et répartition des tâches », Journal des Africanistes 83 (2), p.23-57.
Dugast Stephan, 2014, « Des pierres pour travailler le fer : les outils lithiques des forgerons bassar du Nord-Togo. II. La recherche des pierres : techniques, rites et représentations symboliques », Journal des Africanistes 84 (1), p.156-211.
Froelich, Jean-Claude, Alexandre, Pierre, 1960, « Histoire traditionnelle des Kotokoli et des Bi-Tchambi du Nord-Togo », B.I.F.A.N., série B, XII (1-2), p. 247-260.
Hahn, Hans Peter, 1997, Techniques de Métallurgie au Nord-Togo, Lomé, Presses de l’Université du Bénin.
Hupfeld, Friedrich, 1899, « Die Eisenindustrie in Togo », Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten XI, p.175-194.
Kachinsky, Vitald, 1933, « Les gisements de fer au Togo », Togo-Cameroun 1933/10, Agence économique des territoires africains sous mandat, p. 179-185.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97328904/f23.image
Kouriatchy, Nicolas, 1933, « Contribution à la géologie du territoire du Togo placé sous mandat de la France », Bulletin du Comité d'Études Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française XVI (4), p. 493-629. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1227461/f535.image
Lawson, Daku Tete, 1972, Rapport de mission sur la formation de la cuvette ferrifère du Buem au Togo (circonscription administrative de Bassari). Janvier-Octobre 1966, Lomé, Bureau National de Recherche Minière.
Martinelli, Bruno, 1982, Métallurgistes Bassar, Lomé, Etudes/Documents de Sciences Humaines 5.
Pawlik, Jacek Jan, 1990. Expérience sociale de la mort : Étude des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo, Fribourg, Editions universitaires.
ROBION-BRUNNER, Caroline, COUSTURES, Marie-Pierre, DUGAST, Stéphan, TCHETRE-GBANDI, Assouman et BÉZIAT, Didier, 2022, « La production du fer en pays bassar (Nord du Togo) du XIIIe au XXe siècles : origines et étapes d’une diversité technique ». Afriques – Débats, méthodes et terrains d’histoire 13.
https://journals.openedition.org/afriques/3408
ROBION-BRUNNER, Caroline, COUSTURES, Marie-Pierre, FARTAHI, Zouhair, 2017, « Bitchabé, le village des forgerons », Toulouse, 48mn. (version française https://www.youtube.com/watch?v=XjVD1L1mCrM; version anglaise https://www.youtube.com/watch?v=ophLzwx0cUc)
Szwark, Marian, 1981, Proverbes et traditions des Bassars du Nord Togo, St Augustin: Haus Völker und Kulturen.
Vincent, Pierre-Louis, Hottin, Gabriel coord., 1984a, Carte géologique du Togo. Feuille de Kara 1 : 200 000, Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et Bureau de Recherche Géologique et Minière de la France (BRGM), carte.
Les recherches les plus récentes ou en cours à Bitchabé
Malgré des travaux de recherche importants, la région de Bassar n’a pas encore livré toutes les informations concernant son passé sidérurgique. C’est ainsi que le programme international et interdisciplinaire SidérEnT (« Sidérurgie et Environnement au Togo », Agence nationale de la recherche) a été initié en 2014, sous la direction de Caroline Robion-Brunner (CNRS). Son objectif est de mobiliser des scientifiques issus de domaines divers (ethnologie, archéologie, archéométrie, géologie, métallurgie, géographie et anthracologie) pour étudier l’histoire économique des métaux. Depuis 2019, ces recherches se poursuivent au sein du programme AFRICA (« Archéologie du Fer : Ressources, Identités, Cultures en Afrique », Commission des fouilles du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères), avec l’objectif d’identifier les réseaux de diffusion et les lieux de consommation du fer.
Les principaux résultats archéologiques de ces programmes sont la mise en évidence de l’usage de plusieurs techniques de transformation du minerai en masse métallique dans cette région d’Afrique de l’Ouest. Dans un espace de seulement 3500 km2, les métallurgistes de Bassar ont produit du fer selon des modes opératoires différents. L’ampleur de cette diversité des pratiques n’avait pas été entièrement mesurée par les travaux antérieurs. Certes, les disparités de morphologie des fourneaux appartenant aux XIXe et XXe siècles avaient été attribuées à l’emploi de minerais de fer de qualité variable, mais sans toutefois en apporter la démonstration scientifique. C’est, tout d’abord, l’observation macroscopique des déchets sidérurgiques entreprise sur plus d’une centaine d’ateliers qui a permis de déterminer qu’il y avait eu pas moins de cinq techniques de réduction différentes. À Bitchabé, deux variantes à la technique mixte de séparation des scories et du fer ont ainsi été identifiées. Les datations radiocarbones, qui permettent de situer la production de fer brut dans cette zone entre les XIIIe et XVe siècles, ont été réalisées sur des charbons de bois prélevés lors des fouilles des années 1980. Cette périodisation des activités doit encore être approfondie et précisée par une meilleure documentation de contextes bien datés afin de valider l’échantillonnage futur des vestiges métallurgiques (minerai, scories, métal, éléments de bas fourneau, etc.) et des charbons de bois. Ces données ainsi chrono-référencées pourront alors être étudiées en laboratoire afin de définir les techniques d’acquisition du minerai de fer, les modes opératoires et de conduites des fourneaux, de calculer le volume de production de fer, de déterminer l’origine de la matière première utilisée pour la fabrication des produits semi-finis ou finis, d’identifier les essences boisées utilisées comme combustible, et enfin d’estimer l’impact de la sidérurgie sur l’environnement. Avec l’objectif de reconstituer l’histoire des techniques métallurgiques, il sera également important de réaliser des analyses métallographiques d’objets métalliques finis mis au jour en contexte archéologique et de préformes (disques de fer) provenant de contextes ethnographiques. L’objectif sera de comparer les structures et d’identifier ou pas une structure des matériaux spécifique à la méthode particulière d’épuration de la masse brute de fer à la boule d’argile.
(Caroline Robion-Brunner et Lebarama Bakrobena, juin 2023)
Histoire de la recherche à Bitchabé
Depuis plus d’un siècle, la région de Bassar fait l’objet d’importantes recherches pluridisciplinaires (histoire, géographie, géologie, archéologie, ethnologie, etc.) donnant une assez bonne connaissance des ressources naturelles présentes, ainsi que de l’histoire des sociétés et de leurs activités. Les investigations ont commencé à la fin du XIXe siècle lorsque les explorateurs et administrateurs allemands parcourent les terres de la colonie. Ils sont les premiers Européens à découvrir les « Bassari » (les habitanrs de Bassar) et à décrire leur mode de vie. La production de fer y est alors régulière. Rapidement, sont mandatés des ingénieurs des mines et des géologues pour caractériser les richesses du sous-sol et évaluer les réserves minérales disponibles en vue de les exploiter. Friedrich Hupfeld, en 1899, donne la première description des principaux gisements de fer de la région de Bassar. Ces travaux sur la géologie se poursuivront dans les années 1930 avec Nicolas Kouriatchy (1933) pour la région de Bassar et Vitald Kachinsky (1933) pour ses alentours, puis dans les années 1970 Daku Tete Lawson (BNRM 1972) et André Le Cocq pour l’ORSTOM affinent les connaissances. En 1984, le Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières français (BRGM) publient la carte géologique de Bassar (Vincent et Hottin, 1984a et b). Les travaux pionniers sur l’histoire et l’ethnologie des peuples du Nord-Togo sont conduits par des administrateurs français, en poste à Bassar ou à proximité dans les années 1940-50 (Froelich et Alexandre 1960). La thèse de Robert Cornevin est plus spécifiquement centrée sur la société et la culture bassar (Cornevin 1962). À un travail de sélection et de compilation des principaux écrits allemands, il joint les données de ses propres investigations, succinctes et parcellaires, mais non sans intérêt. C’est à partir des années 1980 que se mettent en place les premières investigations systématiques et rigoureuses. L’archéologue Philip Layton de Barros (1985, 1986, 1988, 2012, 2020) investigue ainsi les périodes anciennes et propose une chronologie de la production du fer en évaluant sa fluctuation à travers le temps. Sa fouille sur le site de Dekpassanware a permis d’obtenir des datations plaçant le début de la sidérurgie dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest autour du Ve siècle avant notre ère. Les ethnologues Bruno Martinelli (1982) et Hans Peter Hahn (1997) retranscrivent quant à eux les étapes de la métallurgie et l’identité de ses acteurs. Le domaine de la vie rituelle et des croyances ont fait l’objet de deux ouvrages d’ethnologie (Szwark 1981 ; Pawlik 1990). Enfin, les travaux de l’ethnologue Stéphan Dugast (1986, 1992, 1996, 2004, 2009, 2012) abordent un spectre de domaines très large, couvrant aussi bien les aspects technologiques (sidérurgie, agriculture) que ceux relevant de l’organisation sociale (parenté, système résidentiel), économique (échanges, systèmes de production), politique (organisation territoriale, chefferie), ou encore les pratiques rituelles et le symbolisme.
Le canton de Bitchabé a régulièrement fait l’objet d’études scientifiques, que cela soit par l’archéologue américain Philip de Barros ou par l’équipe internationale dirigée par Caroline Robion-Brunner. Dans ce cadre, l’archéologue Lebarama Bakrobena de l’université de Lomé y a consacré ses travaux de recherche en master et en thèse de doctorat (2015, 2018, 2021). Aujourd’hui, il poursuit ses investigations sur les techniques et l’histoire des forgerons de Bitchabé.
(Caroline Robion-Brunner et Lebarama Bakrobena, juin 2023)
Bitchabé dans son paysage
Le canton de Bitchabé se situe à environ vingt-cinq kilomètres à l’ouest de Bassar-ville, de l’autre côté de la rivière Katcha. Actuellement, il comprend 14 villages et couvre une superficie de 150 km2. Son paysage est composé de ruisseaux saisonniers, de plaines et de collines dont l’altitude maximale avoisine les 500 m. C’est sur le flanc de ces collines qu’ont été identifiés la dizaine d’ateliers de réduction répertoriés dans cette zone. Chacun d’entre eux se compose d’une dizaine d’amas de déchets métallurgiques peu volumineux. La production de fer brut semble y avoir été régulière mais faible. Les datations radiocarbones montrent un intervalle de seulement deux siècles pour ce secteur, confirmant le rôle local de cette activité. Des investigations archéologiques plus poussées doivent être menées pour mieux comprendre l’organisation spatiale de ces ateliers, étudier la morphologie des structures de réduction et préciser la chronologie des activités sidérurgiques.
Les modalités des travaux d’extraction du minerai de fer nous échappent encore. Toutefois, les collines ayant abrité les sites de réduction font partie du complexe tillitique ferrifère de base (également appelé mixtite) associé à des formations hématitiques plus ou moins silicifiées (Vincent et Hottin 1984). Elles contiennent donc les gisements métallifères nécessaires à la production de fer brut. La présence de filons de quartz, de quartzites et de grès dans ces terrains a offert aux forgerons de la zone les matières premières indispensables au façonnage de leur outillage (enclumes et marteaux).
Les vestiges de forge sont, quant à eux, visibles dans les plaines, au sein des villages actuels tels que Natchamba, Liwatchoule, Bitchalambe, Bitchobebe, Bidjomambe, Bichabe-centre, Inghale, Bissirkpimbe et Binadjoube. Au détour d’une ruelle, il est commun de voir une imposante enclume ou le sol couvert de scories de forge. Le creusement d’une fondation d’habitation dans le quartier de Bitchatapou (Bichabe-centre) a permis de mettre au jour une cache contenant plus de 150 broyons ayant servi à broyer la loupe de fer afin d’obtenir la poudre indispensable pour l’épuration à la boule d’argile (Bakrobéna 2021).
(Caroline Robion-Brunner et Lebarama Bakrobena, juin 2023)
Bitchabé dans l’histoire
Dans la région de Bassar (Nord du Togo), la production du fer a commencé dès le Ve siècle avant notre ère. Après un hiatus de plusieurs siècles qui reste encore difficilement explicable, cette activité reprend à partir du XIIIe siècle. Les ateliers sont alors établis le long de deux chaînes discontinues de montagnes riches en filons de fer. À la fin du XVe siècle, le pays bassar assiste à une sectorisation géographique des différentes étapes de la chaîne opératoire de la sidérurgie : les villageois de Dimori se spécialisent dans le charbonnage tandis que c’est autour de Bandjeli, Kabou et Bassar, que le minerai de fer est extrait et transformé en métal brut ; ce dernier est acheminé soit à Bitchabé et aux villages des alentours, soit au sud de Bassar, afin d’être transformé en demi-produits destinés à l’exportation ou en divers objets destinés à être consommés sur place. C’est également à cette période que la production du fer s’accroit et devient réellement excédentaire, tournée vers une exportation extra-régionale. Elle continue son expansion jusqu’au XIXe siècle mais certains rapports inter-sociétaux perturbent les échanges et la production. Cette dernière cesse au début du XXe siècle dans la partie Est (Kabou/Bassar) alors qu’autour de la ville de Bandjeli, il faut attendre les années 1950 pour que le fer local soit définitivement remplacé par les importations européennes (De Barros 1985, 1986 ; De Barros et al. 2020 ; Robion-Brunner et al. 2022).
Les datations radiocarbones acquises sur différents sites archéologiques du canton de Bitchabé montrent que les activités sidérurgiques se mettent en place à partir du XIIIe siècle. Toutefois dès la fin du XVe siècle, l’étape de la réduction du minerai de fer y est abandonnée au profit de celle de la forge. Certes, les gisements métallifères à proximité étaient peu abondants mais il semble que la raison de cette spécialisation dans la fabrication de demi-produits et de produits finis ait plutôt coïncidé avec l’accroissement de la production et l’arrivée de nouvelles populations : les traditions orales suggèrent en effet que les forgerons actuellement installés dans le canton de Bitchabé seraient originaires de Mion (Menghou, actuel Ghana) et que leur installation en pays bassar aurait eu lieu au cours de la deuxième moitié du IIe millénaire (Bakrobena 2021). L’état actuel des connaissances ne nous permet pas de dire si ces artisans savaient déjà épurer les masses de fer brut grâce à l’emploi d’une boule d’argile, mais il convient de décrire cette technique originale qui a disparu au cours du XXe siècle. La phase d’épuration de la masse de fer brut est obligatoire. Elle consiste à rassembler le métal en évacuant les impuretés (morceaux de charbons et de scories) et les vides contenus dans la loupe. Le produit de cette étape est une préforme à partir de laquelle le forgeron fabriquera des objets finis. Dans la région de Bitchabé, le préformage permettait la réalisation d’un disque. L’épuration nécessitait l’intervention des hommes pour le concassage de la loupe en morceaux grossiers, ainsi que celle des femmes et des enfants qui pilaient les morceaux périphériques à la loupe, moins riches en fer, en vue de l’obtention d’une poudre. Les hommes fragmentaient la loupe dans leur atelier de forge tandis que les femmes et les enfants utilisaient des bancs de grès naturels (non déplacés) comme mortiers et des marteaux de pierre ronds comme percuteurs afin d’écraser les parties périphériques de la loupe. Ce travail a laissé des traces caractéristiques telles que des cupules plus ou moins larges (de 10 à 40 cm de diamètre) et profondes (de 10 à 40 cm) encore visibles, notamment sur le site des likumanjoole au village de Bitchabé (De Barros et Lucidi 2016). Lorsque les morceaux et la poudre de loupe ont été obtenus, les forgerons passaient à la réalisation des boules d’argile. Sur de la paille, de l’argile était appliquée en un disque plat. En son centre, un morceau de loupe d’environ 10 cm de diamètre était déposé, puis tout autour de ce dernier de plus petits morceaux et enfin le tout était recouvert de poudre de fer. Les forgerons refermaient l’enveloppe d’argile et de paille de façon à former une boule ronde dont l’apparence évoquait celle d’une noix de coco. Après l’avoir mise à sécher au soleil, elle était placée dans le foyer de forge. Après de longues minutes de chauffe à des températures avoisinant 1100°C, le forgeron brisait doucement la coque en argile de la boule sur son enclume grâce à un marteau muni d’un plan de frappe concave.
(Caroline Robion-Brunner et Lebarama Bakrobena, juin 2023)
Bitchabé aujourd’hui
Située au nord du Togo, la région de Bassar fait partie des plus importants centres sidérurgiques précolonial de l’Afrique de l’Ouest. Elle concentre plusieurs ateliers de production de fer brut, ainsi que des centres de transformation du fer brut en demi-produits ou en objets finis. Dans le canton de Bitchabé, on trouve les traces des étapes de la réduction du minerai, de l’épuration de la loupe de fer brut et du forgeage. Toutefois, c’est de l’exécution des deux dernières étapes que cette localité tire sa renommée et son nom, qui signifie en langue locale (Ntcham) « Forgerons ». L’originalité de la forge bassar réside dans la méthode d’obtention de la préforme en fer et dans l’usage d’outils en pierre. En effet, que ce soient les supports pour concasser la loupe en fer, les enclumes ou encore les marteaux pour compacter et déformer le fer chaud, tous étaient façonnés dans des quartzites ou des grès-quartzites. Bitchabé fait partie des sept sites archéologiques du pays bassar proposés pour une inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; son enregistrement sur la liste indicative du Togo a été acté début 2022. À ce titre, il figure dans le parcours de visite touristique appelé « la route du fer à Bassar ». Dans le cadre du projet FSPI « Patrimoine paléométallurgique de Bassar » (Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères), un atelier de forge y a été réhabilité et une panoplie d’anciens outils appartenant aux forgerons de ce village a été sélectionnée afin d’être conservée et présentée dans l’écomusée de Nangbani (village limitrophe de la ville de Bassar). Le film documentaire « Bitchabé, le village des forgerons », réalisé en 2017, met en lumière les techniques anciennes d’épuration des masses de fer brut des forgerons (Robion-Brunner et al. 2017).
(Caroline Robion-Brunner et Lebarama Bakrobena, juin 2023)
References
ALEBACHEW BELAY, Birru, 2020a, “The ¨Shay Culture¨ Revisited: Recent Archaeological Fieldwork in the Central Highlands of Ethiopia”, Nyame Akuma 93, p.XX
ALEBACHEW BELAY, Birru, 2020b, Megaliths, landscapes and society in the central highlands of Ethiopia: an archaeological research, Doctoral dissertation, Université Toulouse – Jean Jaurès.
ALEBACHEW BELAY, Birru, 2020c, “Interim remarks on newly discovered stelae in the Efrata and Gedem woreda, North Shewa”, Annales d’Éthiopie 33, p. 189-201.
ANFRAY, Francis, 1983, “Tumulus, pierres levées et autres vestiges dans le Manz en Éthiopie”, in J. SEGERT and J. E. BODROGLIGETI (ed.), Ethiopian studies dedicated to Wolf Leslau on the occasion his seventy-fifth birthday, November 14th, 1981, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, p. 508-518.
DERAT, Marie-Laure & JOUQUAND, Anne-Marie, 2012, Gabriel, une église médiévale d’Éthiopie: Interprétations historiques et archéologiques de sites chrétiens autour de Mesḥāla Māryām (Manz, Éthiopie), XVe-XVIIe siècles Addis-Abeba, Centre Français des Études Éthiopiennes.
Fauvelle, F. X., 2020, “Of conversion and conversation: followers of local religions in medieval Ethiopia”, in: A companion to medieval Ethiopia and Eritrea (pp. 113-141). Brill.
FAUVELLE, François-Xavier & POISSONNIER, Bertrand, 2016, “The Shay culture of Ethiopia (tenth to fourteenth century AD): “Pagans” in the time of Christians and Muslims”, African Archaeological Review 33, p. 61-74.
FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier & POISSONNIER, Bertrand (dir.), 2012, La culture Shay d’Ethiopie (Xe-XIVe siècles). Recherches archéologiques et historiques sur une élite païenne, Paris/Addis Abeba, De Boccard/CFEE.
FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier, AYENATCHEW, Deresse, HIRSCH, Bertrand & Bernard, Régis, 2007, “Les monuments mégalithiques du Mänz (nord-Shoa): Un inventaire provisoire”, Annales d’Éthiopie 23, p. 329–398.
https://www.persee.fr/doc/ethio_0066-2127_2007_num_23_1_1513
JOUSSAUME, Roger & Cros Jean-Paul, 2017, Mégalithes d'hier et d'aujourd'hui en Éthiopie, Paris, Éditions Errance.
POISSONNIER, Bertrand & HIRSCH, Bertrand, 2000, Report on the Megalithic Structures of Mehal Wenz, Addis Abeba, Centre Français des Études Ethiopiennes, ARCCH, p. 4.
SOLEILLET, Paul, 1886, Voyages en Éthiopie, Rouen, Imprimerie de Espérance Cagniard.
https://archive.org/details/voyagesenthiopi01solegoog/mode/2up
TADDESSE, Tamirat, 1972, “A short note on the traditions of pagan resistance to the Ethiopian Church (14th and 15th centuries)”, Journal of Ethiopian Studies 10(1), p. 137-150.
https://www.jstor.org/stable/41965851
TEKLE, Hagos, 2000, “Preliminary notes on the Stelae of Efrata and Gidim of northern Shoa”, Annales d’Éthiopie 16, p. 55-58.
Recent and on-going works on the Megalithic Monuments of the Shay Culture
As discussed in section three, a Ph.D. project by Alebachew Belay Birru (2016-2020) at the Université of Toulouse Jean-Jaurès, France, continued to address issues such as the geographic extent of the culture, typo-morphological scope of the megaliths, settlements of the builders, as well as local memories associated with the megalithic sites that were left for an in-depth archaeological inquiry. The study of the distribution of megalithic sites portrays the relative concentration of structures in different parts of the study area, irrespective of their size and typology. Accordingly, classification of the region into core, periphery-core and periphery was made possible based on the spatial position of monuments and related criteria; it permitted to demonstrate the differences among monuments and sites based on their surface features. The GIS maps with magnified illustration presented in the thesis depict this idea in a much more tangible manner. The spatial distribution analysis also reveals two contextual aspects of the culture, namely, first, the connection with specific geographic features such as rivers and uplands, and second, directions followed by the spread of the Shay Culture on the Central Highlands. Two directions are suggested from the west and center, both oriented towards the east with intermittent continuation to the northwest. These hypotheses can be used as a base map for subsequent sub-surface and comparative studies. Besides, the number of sites documented by Alebachew (2020b) has now reached over three hundred. Currently, the researcher is looking for funds to further explore, and excavate selected sites with particular emphasis on the two special megalithic sites and monuments called Sayǝṭān Gur that are found in Menz, as discussed else where in this paper, to better understand the genesis of megalithic culture of the region. Meanwhile, understanding the origin and circulation of the burial goods so far discovered particularly beads which are also prevalent in recently excavated Christian and Islamic sites is the other project on-progress.
(Alebachew Belay Birru, February 2023)
History of archaeological research on the Megalithic Monuments of the Shay Culture
Some of the megalithic sites in the region, particularly the stelae found in the vicinity of Debre Berhan, were visited and noted by travellers such as a Frenchman Paul Soleillet in 1882 (Soleillet, 1886), and an Italian, Antonio Cecchi, in 1886. A century later, in 1982, French archaeologist Francis Anfray visited the stelae that Soleillet had documented earlier and some other megalithic and medieval sites in the Menz area (Anfray, 1983). In 1986, a team of archaeologists from the Ethiopian Heritage Authority (then Centre for Research and Conservation of the Cultural Heritage of Ethiopia) conducted a quick survey on the stelae field of Gadelomeda (Tekle Hagos, 2000). A French archaeological rescue team led by Bertrand Hirsch visited this same site in 1999 and conducted test excavations (Poissonnier & Hirsch, 2000). In 1997, a survey specifically devoted to the megalithic sites was started by an Ethio-French team led by François-Xavier Fauvelle that continued intermittently up to 2008, signaling some of the major megalithic sites in the districts of Menz Mama, Menz Gera, and Menz Qeya: about ninety megalithic sites were identified in the aforesaid three areas (Fauvelle-Aymar et al., 2007). The archaeological campaign conducted at the royal camp and church sites called Gebriel in Meshale Maryam also included survey and excavation of megalithic monuments (Derat & Jouquand, 2017). Test or rescue excavations were carried out at sites such as Qopros, Ṭaṭar Gur, Meshale Maryam, and Ketetiya (Fauvelle & Poissonnier, 2016).
Regarding the typology of artifacts collected, ceramic is dominant. The discovery of intact potteries enabled the researchers to identify the peculiar features of the Shay culture pottery. The presence of beads among the burial goods was taken as one of the indicators for the “pagan”, or rather, traditional-religious, nature of the culture, because the presence of goods accompanying multiple inhumations is not common in either Christian or Islamic traditions. There are also objects made of different metals. The source of imported elements among the collected artefacts was the other issue that interested the researchers: typo-chronological comparison enabled them to trace their origin from different countries in the Far East such as China and Korea, South Asia as well as the Middle East. The presence of these imported objects led the researchers to think of the trading networks of the Shay culture society with the Muslim kingdoms to the South and East of the Central Highlands. Additionally, four radiocarbon (C-14) dates were generated from charcoal samples from Ṭaṭar Gur in Menz and Qetetiya in Wollo. Based on this, the temporal scope of the Shay culture was set between the 10th and 14th centuries. To sum up, the researches in the Shay Culture brought to light a neglected subject in the medieval archaeology and history of Ethiopia. Identification of the typology and chronology of monuments and artefacts was also a great deal. However, as the researchers themselves witnessed, the study of the Shay Culture was not a complete business (Fauvelle & Poissonnier, 2016: 70; Joussaume & Cros, 2017: 249).
(Alebachew Belay Birru, February 2023)
The Megalithic Monuments of the Shay Culture in their Landscape
The distribution of megalithic sites on the Central Highlands of Ethiopia follows divergent topographic features. There are cases where these sites are found concentrated along river banks and chains of plateaus. The geographic contrast in the region from the highland to the mid- and lowlands, with clear deviation in typology, is another enduring feature of megalithism in the region. As one moves from the tumuli-dominated highlands of Menz towards Ifat in the east, there continues the tumuli tradition but lesser in quantity, with the gradual appearance of stelae culminating with the sole presence of dressed and decorated stelae in Gadelomeda and Ergotila areas, that are adjacent to the megalithic Islam graveyard sites in the east (Alebachew, 2020b; Alebachew, 2020c). These contextual aspects of the Shay Culture can be seen as the major outcome of the study of the spatial expanse of megalithic monuments in the area.
Geographically, both the surveys and excavations encompass megalithic sites in Menz area, particularly Mama, Gera, and Qeya Gebriel, as well as Efrata-Gedem and Mida-Woremo in North Shewa and Ketetiya, Jama and Woreilu in South Wollo. However, due to the massive distribution of monuments, particularly tumuli in Menz and adjacent areas, it is impossible to consider these areas as the sole expanses of the Shay culture. The typology and morphology of monuments and artifacts identified through prospections and excavations are also diverse. For instance, these research works confirmed the presence of three major types of megalithic structures, i.e. tumuli, stelae as well as dolmen, with a total of over three hundred monuments and sites. This concentration of tumuli makes the region special as compared to other megalithic sites in the Southern Ethiopia that are known for the wider distribution of stelae. Furthermore, two extraordinary megalithic sites were documented by the present researcher for the first time (Alebachew, 2020a; Alebachew, 2020b). Interestingly, though they are unrelated, these two monuments are both called Sayǝṭān Gur (“Mound of Satan”). The sites are located in the neighboring districts of Menz Lalo and Menz Mama, with about 30 km distance in between. Their location on a plateau landscape with gorges to their west is evident. The sites are singled out from hundreds of megalithic sites in the study area because of the megalithic complexes they possess. Besides, they are considered as sites rather than monuments because they feature different types of megalithic structures such as pillars, platforms and enclosure associated with the tumulus in both cases (Alebachew, 2020b). The other special type of megalithic structure which was considered in the studies is hypogeum (underground burial). It seems that this kind of burial is not common in the megalithic studies of Ethiopia and elsewhere, except a few examples from Arsi (Joussaume & Cros, 2017).
(Alebachew Belay Birru, February 2023)