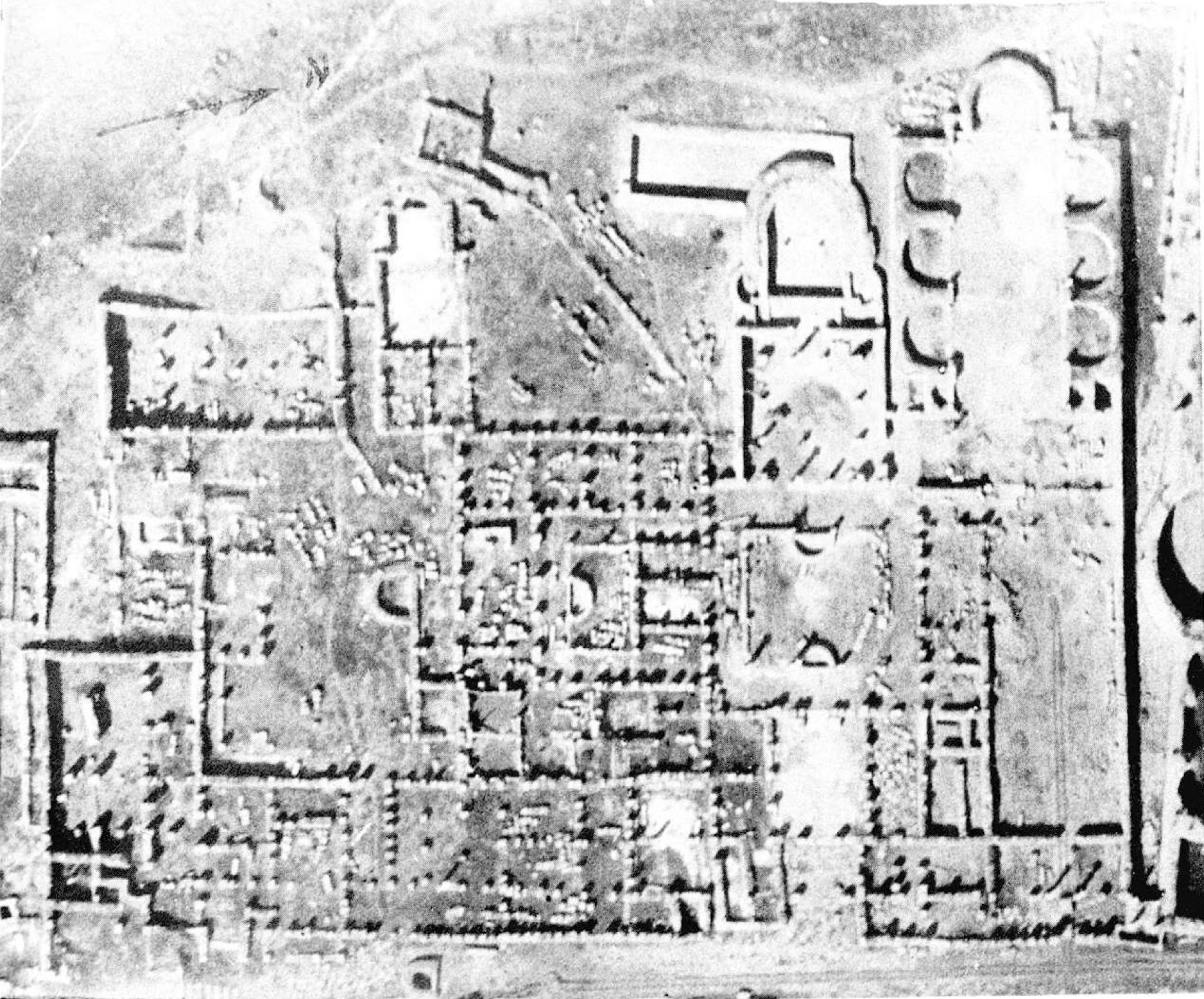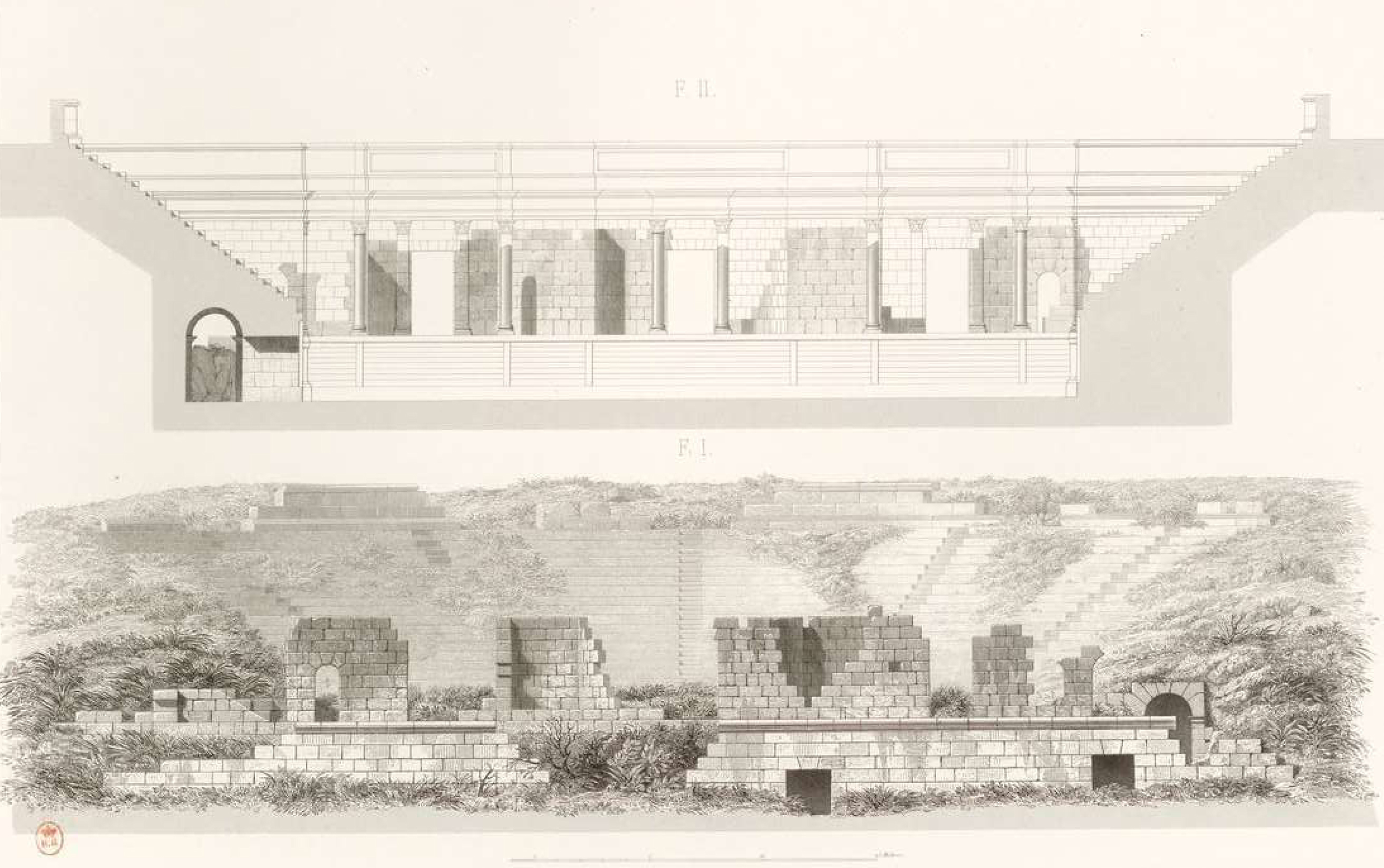La ville est placée au carrefour de la route est-ouest reliant l’ancienne capitale numide Cirta/Constantine à la colonie nervienne de Sitifis/Sétif, et de l’axe nord-sud reliant Igilgili/Jijel à Lambaesis/Lambèse (Gascou, 1972). Le site est installé sur un plateau rocheux d’une trentaine d’hectares facilement défendable, long de 400 m environ et culminant à une altitude moyenne de 850 m, cerné par deux torrents de montagne profondément encaissés, à savoir à l’est l’oued Bettane et l’oued Guergour à l’ouest. Le choix d’implantation du site a été conditionné par la présence d’importantes réserves d’eau et l’abondance de sources intarissables, mais aussi par un arrière-pays favorable à l’agriculture. L’agglomération primitive a pu être délimitée sur la partie nord de l’éperon, enfermée dans un rempart dont le tracé, relativement bien connu et restauré à une époque tardive, ce rempart dessine un plan triangulaire irrégulier. Partiellement conservé sur parfois 2 à 3 m d’élévation, il est constitué d’un blocage de caillasse et moellons pris entre deux parements en grand appareil et gros moellons pour une épaisseur globale de 2,50 m (Allais, 1971). L’urbanisme intérieur est constitué d’un alignement de rues selon une orientation générale nord-ouest/sud-est avec le grand cardo à l’ouest qui travers tout l’éperon et au bord duquel sont installés depuis le milieu du IIe siècle le forum ainsi que la basilique et le marché des Cosinii (Février, 1996a). Dès le milieu du IIe siècle, en parallèle avec la poursuite de l’aménagement du noyau primitif, la ville s’étend en dehors des remparts, dans la partie méridionale du plateau avec la construction d’un théâtre de 3000 places, des Thermes du Sud édifiées sous le règne de Commode, ou encore de la partie la plus ancienne de la « Maison de Bacchus » (Golvin, 2020). D’autres travaux sont réalisés à la période sévérienne (193-235), comme l’aménagement de la grande place dite forum des Sévères. L’essentiel des constructions de Cuicul a pu être assurément daté grâce aux nombreux témoignages épigraphiques découverts lors des fouilles, même s’il existe deux hiatus chronologiques, du fait de l’absence de dédicaces, entre l’époque des Sévères et 281 d’une part, entre 295 et la seconde moitié du IVe siècle d’autre part (Février, 1996a). Les IVe et Ve siècles sont capitaux dans le paysage urbain de Cuicul puisqu’ils représentent l’état le plus récent du site, comprenant l’édification de l’important ensemble monumental du groupe épiscopal, de nombreux bâtiments publics et de grandes maisons richement décorées de mosaïques (Blanchard-Lemée, 1975, 1998). Concernant l’approvisionnement en eau, bien que Cuicul fût dotée de quelques puits, l’alimentation principale était générée en continue par un aqueduc qui captait l’eau des sources au sud de la ville, puis se divisait en plusieurs branches souterraines afin d’alimenter les différents quartiers et de grandes citernes, ces dernières collectant également les eaux de pluies employées notamment dans les thermes de Cuicul. Plusieurs fontaines installées en divers points de la cité assuraient la distribution (Allais, 1933). La documentation archéologique concernant Cuicul/Djemila est considérable, mais paradoxalement difficilement exploitable. Paul-Albert Février, qui a activement contribué à la connaissance scientifique du site à partir des années 1960, regrette l’imprécision des plans anciens des divers monuments ainsi que la faiblesse des descriptions au moment de la découverte et avant restauration (Février, 1996a). En effet, les rapports d’Albert Ballu contiennent nombre de descriptions confuses, de plans inexacts ou sommaires qui rendent difficile la compréhension a posteriori des découvertes, mais demeurent des sources irremplaçables (Blanchard-Lemée, 1975). En effet, Malgré le nombre important d’interventions archéologiques tout au long du XXe siècle, nous n’avons aujourd’hui que trop peu de données géologiques, géomorphologiques, et surtout stratigraphiques en dehors des sondages de la « Maison de l’Âne » (Blanchard-Lemée, 1975).
(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)