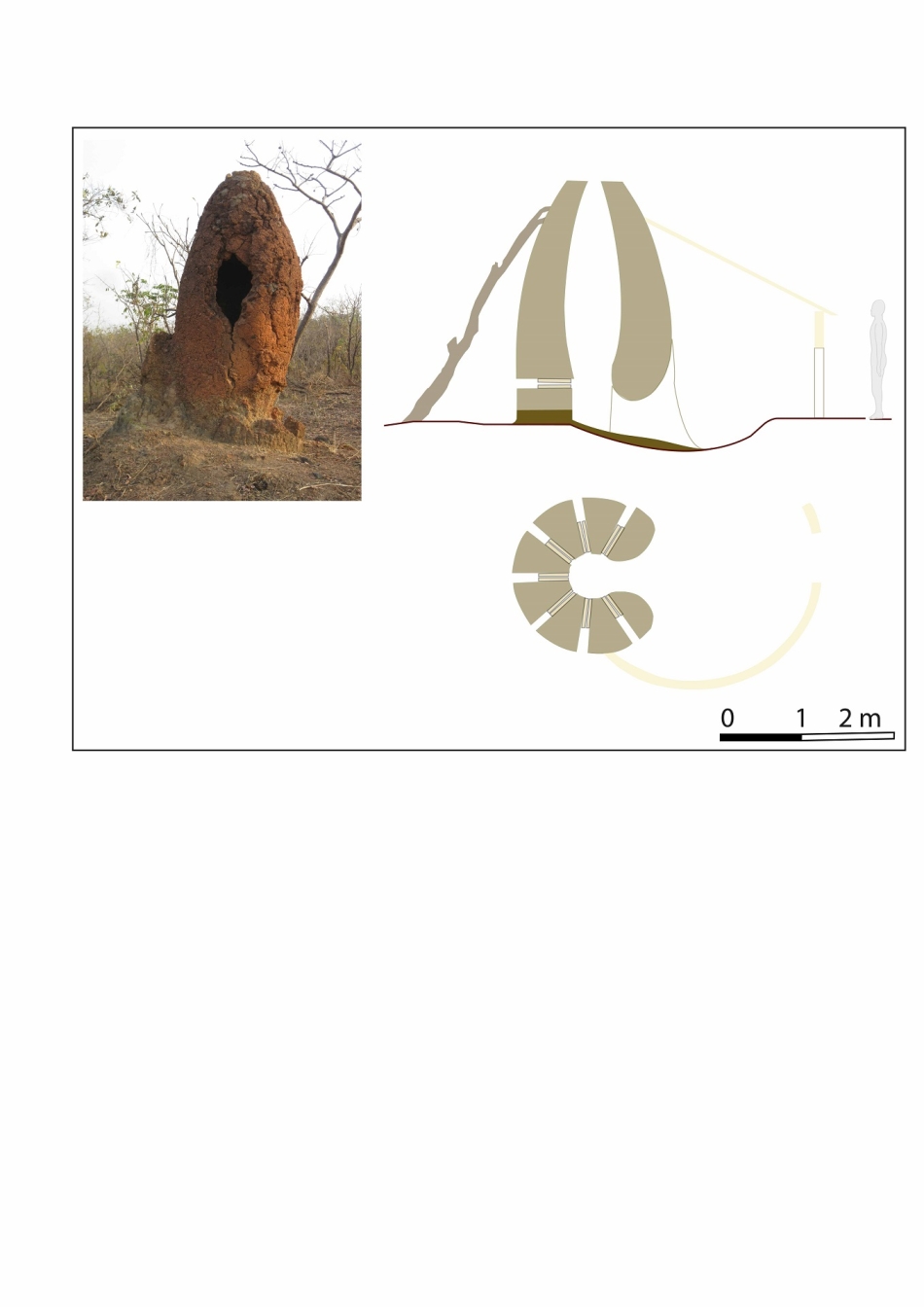Depuis plus d’un siècle, la région de Bassar est l’objet d’importantes recherches pluridisciplinaires (histoire, géographie, géologie, archéologie, ethnologie, etc.) donnant une assez bonne connaissance des ressources naturelles présentes, ainsi que de l’histoire des hommes et de leurs activités. Les investigations commencent à la fin du XIXe siècle lorsque les explorateurs et administrateurs allemands parcourent les terres de la colonie. Ils sont les premiers Européens à découvrir les « Bassari » et à décrire leur mode de vie. La production de fer y est alors régulière. Rapidement, sont mandatés des ingénieurs des mines et des géologues pour caractériser les richesses du sous-sol et évaluer les réserves minérales disponibles en vue de les exploiter. Friedrich Hupfeld, en 1899, donne la première description des principaux gisements de fer de la région de Bassar, dont ceux du secteur de Tatré. Ces travaux sur la géologie se poursuivront dans les années 1930 avec Nicolas Kouriatchy (1933) pour la région de Bassar et Vitald Kachinsky (1933) pour ses alentours, puis dans les années 1970 Daku Tete Lawson (BNRM 1972) et André Le Cocq pour l’ORSTOM affinent les connaissances. En 1984, le Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières français (BRGM) publient la carte géologique de Bassar (Vincent et Hottin coord. 1984a et b). Les travaux pionniers sur l’histoire et l’ethnologie des peuples du Nord-Togo sont conduits par des administrateurs français, en poste à Bassar ou à proximité dans les années 1940-50 (Froelich et Alexrandre 1960). La thèse de Robert Cornevin est plus spécifiquement centrée sur la société et la culture bassar (Cornevin 1962). À un travail de sélection et de compilation des principaux écrits allemands, il joint les données de ses propres investigations, succinctes et parcellaires, mais non sans intérêt. C’est à partir des années 1980 que se mettent en place les premières investigations systématiques et rigoureuses. L’archéologue Philip Layton de Barros (1985, 1986, 1988, 2012, 2020) investigue ainsi les périodes anciennes et propose une chronologie de la production du fer en évaluant sa fluctuation à travers le temps. Sa fouille sur le site de Dekpassanware a permis d’obtenir des datations plaçant le début de la sidérurgie dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest autour du Ve siècle avant notre ère. Les ethnologues Bruno Martinelli (1982) et Hans Peter Hahn (1997) retranscrivent quant à eux les étapes de la métallurgie et l’identité de ces acteurs. Le domaine de la vie rituelle et des croyances ont fait l’objet de deux ouvrages d’ethnologie (Szwark 1981 ; Pawlik 1990). Enfin, les travaux de l’ethnologue Stéphan Dugast (1986, 1992, 1996, 2004, 2009, 2012) abordent un spectre de domaines très large, couvrant aussi bien les aspects technologiques (sidérurgie, agriculture) que ceux relevant de l’organisation sociale (parenté, système résidentiel), économique (échanges, systèmes de production), politique (organisation territoriale, chefferie), ou les pratiques rituelles et le symbolisme.
Le site de Tatré-Apétandjore n’a pas fait l’objet d’étude scientifique particulière avant les années 2010. Le secteur de Tatré est pourtant mentionné sur les cartes des colons allemands et dans les travaux des historiens étudiant la région de Bassar comme productrice de fer. Les sondages et les datations radiocarbones réalisés par P. de Barros sur les sites de Tatré 4 et 6 et les sites d’anciens habitats de Dukuntunde et Didjobre dans les années 1980 situent les débuts de cette activité au XIIe siècle.
(Caroline Robion-Brunner, février 2023)